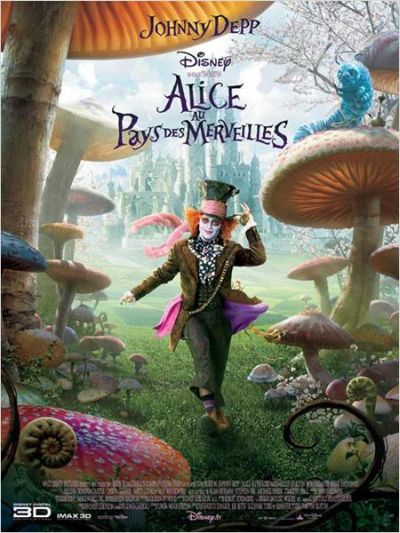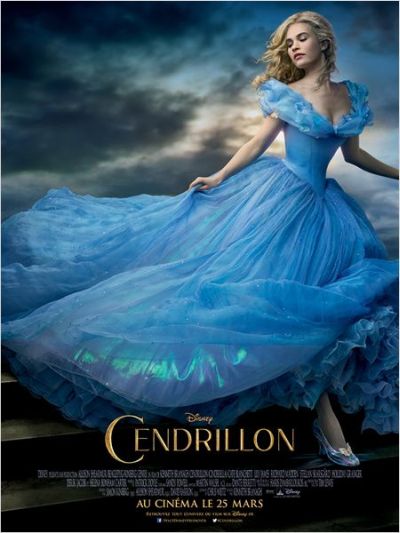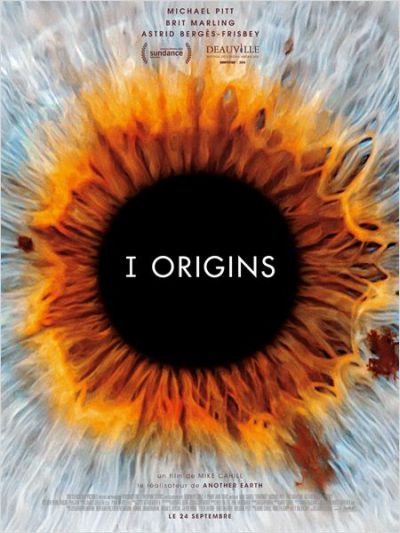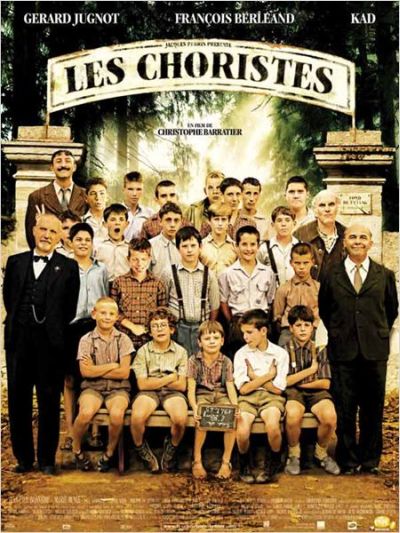Les Enfants Loups, Ame & Yuki
2012
Mamoru Hosoda
Si de temps à autre un studio américain d’animation arrive à pondre un chef d’œuvre, il faut bien avouer que le monde entier souffre la comparaison face à l’industrie nippone et ses bijoux sur pattes. Seulement la qualité a un prix, celui de notre santé mentale, car bien souvent qui dit histoire magnifique implique destin tragique et film dépressif. L’an dernier Le Vent se lève et Kaguya justifiaient à eux seuls le leadership mondial du Japon en matière de suicide, et encore une fois le mouchoir sera accompagné du scalpel. Mais avec l’homme à qui l’on doit l’époustouflant Summer War aux commandes, la curiosité a fini par surpasser l’appréhension.
Parfois on rêve de choses fantastiques, mais parfois on aimerait un retour à des choses plus normales. Pour Hana, son histoire commençait comme un conte de fée, rencontrant sur les bancs de la fac un mystérieux jeune homme, grand, fort et séduisant. Un beau jour il lui dévoila son secret, sa nature d’homme loup, capable de métamorphose. Leur amour fut immédiat, fougueux, et en naquit deux magnifiques enfants, Ame et Yuki. Mais alors qu’ils étaient encore très jeunes, leur père ne revint pas de l’une de ses chasses, plaisir coupable de sa vie animal qui lui coûta la vie. Hana va alors se retrouver seule, et décidera de partir à la campagne pour élever ses deux enfants-loups à l’abris des regards.
Avec son dernier long-métrage, le doute n’était pas permis, mais le film confirme son statut de bijoux visuel, démontrant si besoin était que le dessin à la main surclassera indéfiniment les animations 3D, même si les prouesses artistiques y restent possible. Encore une fois les décors magnifient la réalité, et les personnages sont presque les plus beaux du genre. Une direction artistique remarquable jusqu’aux transformations animales, bien qu’encore plus probantes pour Yuki dont la chevelure s’intègre mieux et sonne plus naturelle. La véritable interrogation autour du film résidait dans son scénario. Si sur bien des aspects l’histoire est magnifique, bourrée d’idées exceptionnelles, elle déçoit un peu dans son ensemble. L’apparition du maître dans la seconde moitié laissait espérer, mais non, la mythologie autour des hommes-loups n’est tout simplement pas abordée. En revanche, avec Yuki la jeune fille fofolle, et Ame, jeune garçon solitaire, on voit deux appréhension différentes de ce qu’est la vie d’homme-loup, et c’est une totale réussite. La fille est d’abord très enjouée et vit cette dualité à fond, avant de vouloir se fondre dans le moule pour mener une existence plus humaine, tandis que son frère lui redoutait dans un premier temps le monde sauvage et rognait sa nature louve, puis découvrira finalement le sens de la communion et l’importance qu’il peut avoir sur l’écosystème. On ne se rendait pas vraiment compte qu’il y avait un choix à faire, mais en nous montrant le cheminement des deux enfants, le film propose un questionnement passionnant, bien que pas totalement abouti, et on ne sait pas trop si il aurait fallut aller encore plus loin chronologiquement, ou si au contraire les premières années à la campagne auraient mérité un film entier. On en ressort triste, ayant eu la démonstration de toutes les imperfections du monde, voyant de pauvres enfants se briser face à tant de désillusions. Une petite perle artistique à l’histoire sublime, mais qui s’est perdue en route puis s’est noyée dans son chagrin.