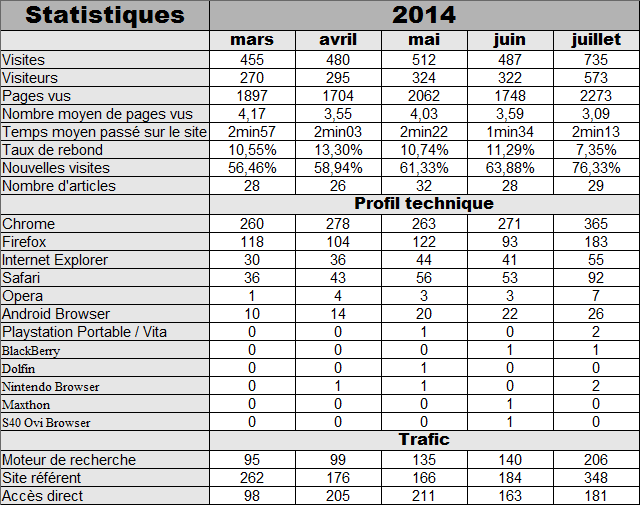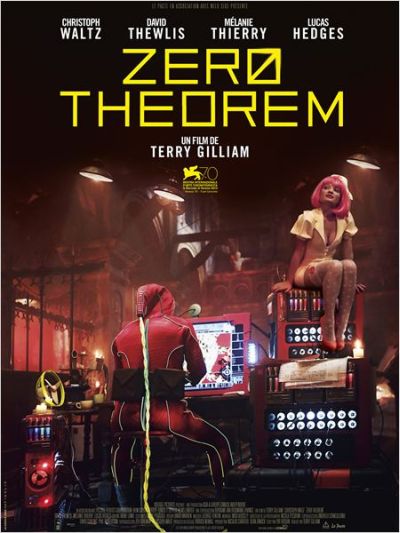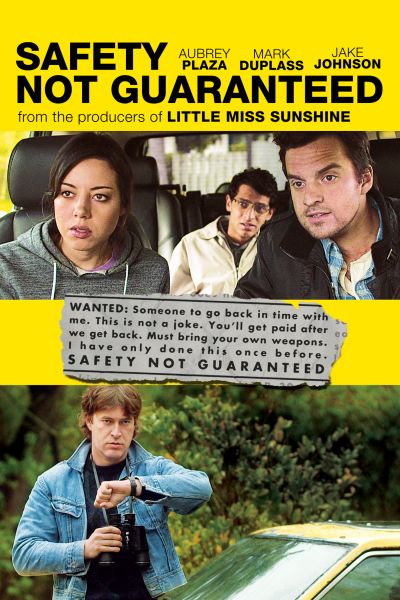Her
2014
Spike Jonze
Golden Globes, Oscar : d’une seule voix le prix du meilleur scénario original fut décerné. Dans un monde où la technologie prend chaque jour une place plus importante, s’attaquer à l’attirance qu’il pourrait y avoir entre l’homme et la machine semble en effet être une vision perspicace et novatrice de l’avenir, mais uniquement pour les non-initiés au genre. En effet, l’idée de date pas d’hier, que ce soit au cinéma avec L’homme bicentenaire, ou dans le jeu vidéo avec la vision inégalable de Mass Effect. Et là, la comparaison devient tout de suite moins brillante.
L’amour est une chimère, et plus le temps passe et plus cette vérité éclate. L’homme est un tendre romantique, brisé par la volatilité des femmes que trop rarement capables de s’attacher. Après sa rupture avec son épouse (Rooney Mara), Theodore (Joaquin Phoenix) s’était juré de ne plus jamais rien tenter de sentimental avec qui que ce soit. Poussé par son amie Amy (Amy Adams) et son nouvel OS pour son ordinateur, Samantha (Scarlett Johansson en VO, Audrey Fleurot en VF), il va pourtant accepter de ressortir, mais même sa belle et jeune prétendante (Olivia Wilde) n’arrivera pas à le faire changer. Son bonheur pourrait bien être au sein de son foyer, avec Samantha, dont les prouesses d’intelligence artificielle lui confèrent une humanité troublante, au point que la question d’une idylle homme-machine semblerait logique.
C’est bien beau de vouloir proposer quelque chose d’un peu moins conventionnel, mais encore faut-il y mettre les formes. Clairement le film n’est pas une œuvre transcendante comme on pouvait l’espérer. L’univers futuriste est réaliste, le style graphique cohérent et les acteurs très bons, de même que la réalisation et globalement la trame de l’histoire. Qu’est-ce qui coince alors ? Le véritable fond du scénario et la structure, sans compter un certain malaise face au ton cru de quelques scènes osées et dont on se serai bien passé. Il faut bien sûr laisser le temps au personnages d’évoluer, établir des liens et matérialiser la mollesse et la paresse de son héros, mais par le fait le film se vautre dans un rythme assommant de lenteur, pollué par des plans inutiles et interminables. Et puis bien évidemment, il reste le scénario, de base intéressant, mais dans les faits paresseux. Une machine peut-elle avoir peur de mourir ? Cherche t-elle un sens à sa vie ? Se sentent-elles liées entre elles ? Plein de questions pertinentes et magnifiquement mises en scènes, mais il est regrettable de devoir attendre aussi longtemps pour élever le débat, et la finalité est très décevante tant elle ne retient pas les erreurs du genre sur le besoin de focalisation unitaire des machines, sans quoi le chaos est la seule réponse possible. Mais malgré un rythme affreux et un scénario trop frileux avant la dernière ligne droite, le film reste une belle tentative faite avec talent, et c’est un effort à saluer.