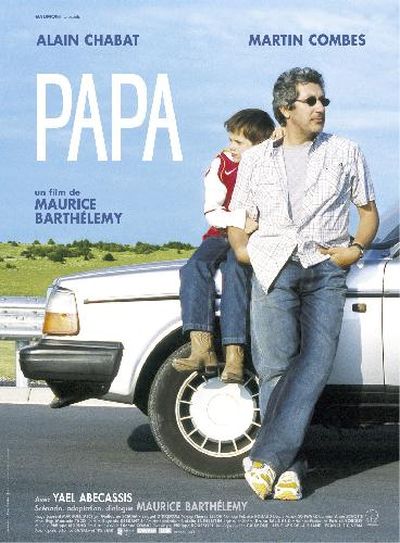Avengers Endgame
2019
Joe Russo, Anthony Russo
Initié il y a 11 ans avec Iron Man, l’univers du MCU arrive au terme d’une époque, clôturant un arc de 22 films avec l’histoire de Thanos (Josh Brolin), annoncé depuis le grand rassemblement des Avengers en 2012. Un événement cinématographique sans pareil puisqu’avant même la sortie du film la franchise avait généré plus de 18 milliards au box-office mondial, soit plus de deux milliards de spectateurs. La première partie de cette conclusion épique avait pulvérisé le précédent record de la saga, Infinity War ayant été le premier film de super-héros atteignant la barre des deux milliards de dollars au box-office, se classant alors – hors inflation – quatrième plus gros succès de tous les temps. Il ne faisait aucun doute que cette toute dernière partie allait encore battre des records, mais le raz de marrée pulvérise à l’heure actuelle même les plus folles prévisions : en seulement deux semaines le film s’est hissé à la deuxième place des plus gros succès de l’histoire, et il sera le tout premier à atteindre le seuil des trois milliards, délogeant ainsi une décennie de règne pour Avatar. Un engouement sans commune mesure, dépassant de loin le cercle d’initié d’amateurs de comics, devenant un phénomène mondial qui marquera à jamais l’histoire du cinéma. Si la collaboration entre Disney et Marvel ne s’arrêtera pas là, de nombreux projets sont déjà annoncés pour les années à venir, c’est tout de même la fin d’une ère, et les enjeux de ce film étaient juste fous.
/!\ Attention spoilers, ne pas lire ces lignes si vous n’avez pas vu le film /!\
La première partie, Infinity War, avait laissé les spectateurs en état de choc : le film s’était achevé sur la défaite des héros, Thanos finissant par mettre la main sur les six pierres de l’infinie, et mettant à exécution son plan, à savoir éliminer la moitié de la population d’un univers surpeuplé. Si certains comme Vision (Paul Bettany), Gamora (Zoe Saldana) ou Loki (Tom Hiddleston) ont été tués, d’autres manquent désormais à l’appel suite au claquement doigt : Docteur Strange (Benedict Cumberbatch), les Gardiens de la Galaxie Chris Pratt, Vin Diesel, Dave Bautista et Pom Klementieff) à l’exception de Rocket (Bradley Cooper), Black Panther (Chadwick Boseman), Bucky (Sebastian Stan), Faucon (Anthony Mackie), Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Spider-Man (Tom Holland) et Nick Fury (Samuel L. Jackson) pour ne citer que les principaux. Pour ceux qui restent, Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Natacha Romanoff (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Hawkeye (Jeremy Renner), Scott Lang (Paul Rudd) et Captain Marvel (Brie Larson), il sera question de comment ramener ceux qui sont partis.
Comment annuler un claquement de doigt ? En en faisant un autre : c’était l’une des principales théories, de même que le voyage dans le temps, une ambition qu’on avait pourtant du mal à concevoir dans un tel film. Les scénaristes l’adaptent à leur propre sauce pour leur permettre de ne pas annuler toute forme d’enjeu qu’un simple voyage temporel pourrait résoudre. Le passé y est immuable, le changer ne ferait que créer des réalités alternatives sans changer leur présent à eux. Un concept qui se tient, et il s’agit donc de récupérer les pierres dans le passé, faire un claquement de doigt pour ramener les disparus, puis ramener les pierres pour éviter de créer des mondes alternatifs chaotiques. Bien sûr, tout ne se passera pas comme prévu, et les événements qui amènent au combat final sont bien trouvés et cohérents, bien que créant ainsi des réalités alternatives singulièrement différentes. C’est aussi une petite pirouettes des scénaristes pour laisser certains personnages morts tout en pouvant les exploiter dans d’autres réalités où ils existent encore. Bien sûr, on pourra dire que c’est bien commode que les voyages amènent aux mêmes réalités des mêmes timelines indépendamment de l’évolution des réalités, mais on a vu des histoires de voyages temporels bien moins crédibles. Le combat final est un grand moment épique, et on peut dire que globalement cette conclusion est de grande qualité, offrant un point final à de nombreuses histoires auxquels on s’est attaché.
Place maintenant aux bons gros spoilers pour aborder certains défauts majeurs du film, ou en tous cas des déceptions immenses qui ne seront jamais rattrapées. Certes le film dure trois heures, et c’est bien assez pour tout ce qu’il y a à dire, mais l’équilibrage est très mauvais, certains passages ne servent pas le propos, et au contraire d’autres passages sont trop rushé. On pense par exemple aux photos dans le restaurant ou tout le passage au Nouveau Midgar, de purs gags bien trop longs et qui tombent un peu à l’eau, et on aurait aimé voir plus d’interactions avec le passé, ou même un combat plus long à la fin tant le nombre improbable de combattants empêche toute présence supérieure à dix secondes en dehors des membres fondateurs des Avengers dont deux tirent leur révérence. En résulte des développements de personnages soit inexistants, soit mauvais en dehors du trio de tête formé par Iron Man, Captain America et Thor, et même ce dernier déçoit un peu tant il semble avoir perdu tout enjeu. Deux cas sont même problématiques : Hulk ne sert plus à rien, ni bon scientifique ni bon combattant ; et Captain Marvel, jugée trop forte et laissée de côté pendant la quasi intégralité du film, et son personnage, sympathique et attachant dans son propre film, devient ici un stéréotype imbuvable de femme forte, provoquant quelques haut-le-cœur lors de son retour, affublée d’une coupe de lesbienne qui prouve définitivement que les scénaristes confondent féminisme et misandrie.
Impossible ne pas avoir de pincement au cœur en se disant qu’Iron Man aurait mérité de rester aux côtés de Morgan, sa fille née entre les deux films, et Pepper (Gwyneth Paltrow), et son adieu aurait pu être meilleur. De même, si on sera content pour Captain America qui retrouve enfin son grand amour, on ne pourra qu’être désolé de voir partir un personnage qui avait enfin l’étoffe des grands : le voir prendre Mjolnir est un moment particulièrement jouissif. Reste qu’une nouvelle piste ouverte donne beaucoup envie : les asgardiens de la galaxie. Renonçant au trône au profit de Valkyrie (Tessa Thompson), Thor rejoint l’équipe des Gardiens de la Galaxie à la fin du film, et aux vus des chamboulements causés par les événements de la guerre contre Thanos lors des deux derniers films, l’excitation est à son comble. Le troisième volet, initialement prévu pour 2020, devait donc relancer les enjeux de la licence, mais il faudra finalement attendre 2022 à cause d’une mauvaise blague et d’une réactivité lamentable de la part de Disney. Si la suite de Spider-Man Homecoming sera très certainement un temps fort du MCU, il faudra s’armer de patiente jusqu’en 2021 voir 2022 pour contempler un Docteur Strange 2 ou un Black Panther 2 nous rappelant aux bons souvenirs de nos héros. Avec en prime pas moins de quatre séries programmées sur Scarlet Witch, Hulk, Hawkeye et Loki pour la plateforme Dinsey+, le Marvel Cinematic Universe a encore de beaux jours devant lui, et peut-être même que le meilleur est à venir, mais rien n’est moins sûr. Une page s’est tournée. On en voudrait plus, encore et toujours, mais on peut se réjouir d’un final si grandiose.

![]()