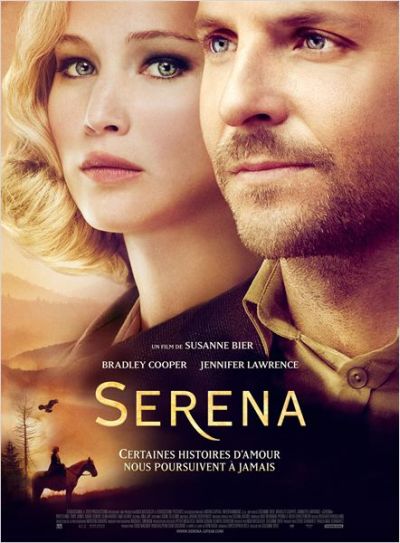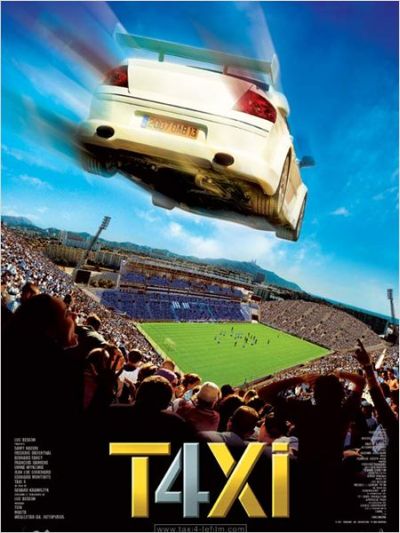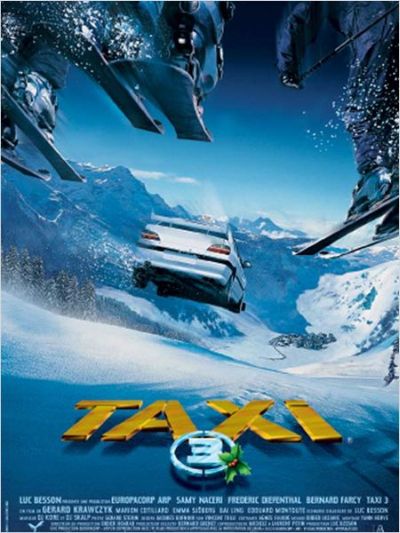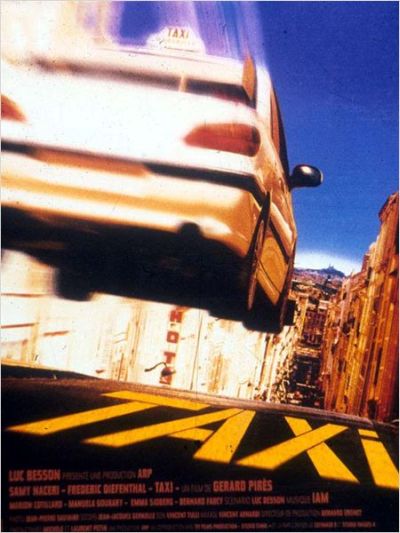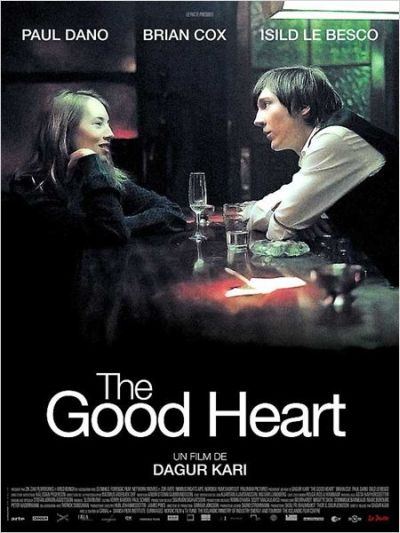Annie
2015
Will Gluck
Célèbre bande-dessinée des années 20, la petite orpheline Annie est ensuite devenu un phénomène mondial avec la célèbre comédie-musicale de Broadway de 1977, adaptée ensuite au cinéma cinq ans plus tard avec un succès retentissant. Des chansons mythiques que ce remake ambitionnait de remettre au goût du jour à la sauce pop, pour un résultat globalement massacré par les critiques et qui doit son salut commercial à une belle période de Noël aux Etats-Unis. Pourtant, il n’y a vraiment pas de quoi avoir honte.
L’histoire de ce remake se situe 80 ans plus tard mais le contexte reste le même. Abandonnée par ses parents, Annie (Quvenzhané Wallis) fut recueillie par la vilaine Hannigan (Cameron Diaz), plus intéressée par les avantages sociaux que lui rapporte la garde qu’aux enfants, sale vermine rampante. Une pauvre orpheline dont la route va croiser celle de Will Stacks (Jamie Foxx), riche patron d’une société de téléphonie mobile et candidat à la mairie, qui la sauvera involontairement. Un fait qui le propulsera des les sondages, donnant l’idée à son conseillé en communication de prendre sous son aile la petite fille défavorisée, source inopinée de popularité. Un arrangement malhonnête mais dont Annie compte bien tirer avantage.
L’histoire était très bonne en théorie : une petite fille attendrissant le cœur aigri d’un patron acharné de travail, passant de la pauvreté et du rejet au luxe et à l’amour. Les mouchoirs étaient prêts, mais ne seront malheureusement pas utilisés. Que tout soit téléphoné est une chose, mais le vrai problème vient de l’humour, plus que douteux, ne pouvant s’empêcher de s’immiscer dans les quelques passages qui auraient pu nous attendrir. Enfin bon, quand on a Rose Byrne au casting, co-responsable des pires étrons de l’histoire de la comédie, il fallait s’y attendre. Mais tout de même, la course-poursuite finale atteint un si haut degré de bêtise et d’incohérence, sans compter les interventions catastrophiques de la nullissime Cameron Diaz, que l’indigestion est consommée. Heureusement, un point vient sauver le tableau : les musiques (sauf pour la VF, absolument insupportable tant en terme de raccord, de paroles ou d’interprétation). La mise à jour est assez largement réussie, les thèmes entraînants, les acteurs convaincants, notamment la jeune Quvenzhané Wallis qui confirme son statut de prodige, et on pourrait carrément parler de tube pour certaines chansons comme « Hard Knock Life », à écouter encore une fois en VO, comme de toute façon la totalité des comédies musicales, car même la localisation saluée de La Reine des neiges ne tenait pas la comparaison face à l’originale. Un film écrit avec les pieds, à l’histoire fade et à l’humour gras, dégoulinant de bons sentiments et mièvre au dernier degré, mais l’héroïne est tellement parfaite, l’ambiance si réjouissante et les musiques si entraînantes qu’on lui pardonne volontiers.