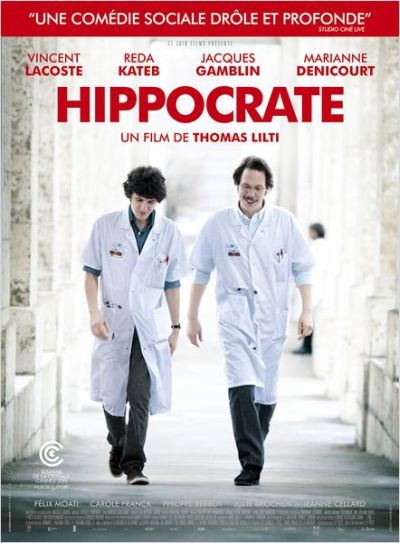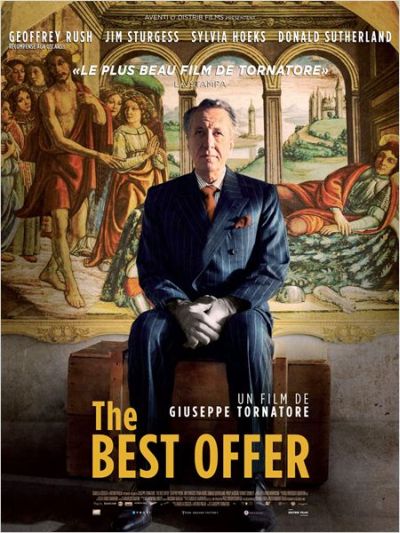Final Fantasy XIII
2014 (2010 sur consoles)
PC
Après avoir mit un certain à s’implanter sur Super Nintendo, la franchise Final Fantasy a connu une période de gloire monumental sur Playstation et Playstation 2, et sa première incarnation sur la troisième génération de consoles Sony était passablement attendue. Un développement chaotique qui fait doucement sourire aujourd’hui avec le quinzième volet et ses dix ans de programmation, mais à l’époque on ne rigolait pas avec ça, le jeu ayant été repoussé trois années durant. Accueilli tièdement à sa sortie, le jeu débarqua avec surprise sur PC à la rentrée 2014, me permettant enfin de découvrir le fameux titre (et ses deux suites, l’une étant déjà sortie). Après l’excellence de FFXII, je croyais la saga sur de bons rails, mais patatras, cet épisode fait l’exact chemin inverse, lorgnant du côté de FFX, pourtant le plus mauvais de toute la série (si on excepte les deux premiers).
Graphismes : 17/20
Incontestablement l’un des meilleurs arguments du jeu. Si déjà le précédent était une prouesse ahurissante, celui-ci, et c’est bien normal vu le changement de plateforme, se montre encore plus beau et percutant. Et encore, j’ai eu la flemme d’installer la mise à jour pour un affichage supérieur à 720p. La modélisation des personnages se rapproche énormément des cinématiques, et si on est pas encore à afficher le grain de la peau ou des textures aussi fines qu’un vaste champ d’herbe où chaque brin est modélisé, c’est par moments presque bluffant. D’un point de vu purement technique, on frôle la perfection et les décors – pas tous mais certains – sont spectaculaires, dénotant d’une ambition démesurée. Une splendeur décuplée par la mise en scène, point crucial du jeu tant les efforts fait à ce niveau là sont considérables. On retrouve aussi une belle diversité qui ne gâche rien au spectacle. En revanche, la direction artistique n’a rien de transcendante, faisant du Final Fantasy classique, recyclant son bestiaire à la sauce baroque. On notera même quelques ratages, notamment Shaz, et à l’exception de Fang et Lightning, les designs des personnages sont totalement clichés. Un boulot exceptionnel donc, mais pas forcément très inspiré.
Jouabilité : 12/20
Nous voilà au cœur de l’un des plus gros problèmes du jeu. C’est à croire qu’ils l’ont fait exprès : on assiste à un mixe bancal de FFX et FFXII. Le Sphérier ? Copié-collé en moins bien. Les Gambits ? Réappropriés dans la douleur. Pour des raisons de coût en terme de puissance de calcul, le système du XII est repris dans une bulle local, perdant ainsi en dynamisme, mais pire encore, on perd surtout la liberté de déplacement. On retourne à du combat classique et mou, mais il y a plus grave. Si les combats sont comme dans le précédent jeu, c’est-à-dire automatisés selon une stratégie, avec possibilité de changer cette stratégie en temps réel (un petit plus) et de choisir la commande manuellement, on ne peut plus calibrer ses attaques, échangeant les commandes individuelles par des menus, plus globaux et moins précis. Et l’IA est à ce niveau très défaillante, manquant de jugeote face aux mêlées, ne privilégiant pas assez les attaques de zone, et elle perd énormément en efficacité quand on se retrouve en situation d’urgence avec deux soigneurs, n’ayant strictement aucun sens de la coordination. Une IA globalement dégueulasse, même pour ce qui est des ennemis, souvent coriaces et forçant à se taper du level up (enfin sphérier up plutôt), mais sinon stupide dans ses actions.
Cœur du système évolutif des personnages, le sphérier, ultra dirigiste, se décompose en six rôles : attaquant (pour une force de frappe maximum), ravageur (magie affaiblissant les ennemis – jauge de choc – et leur causant des dégâts légèrement inférieur), défenseur (tank se régénérant et attirant les attaques ennemis), saboteur (causant des altérations d’état aux ennemis), technicien (offrant des bonus de stats aux personnages), et soigneur (qui restaure les PV, soigne les altérations d’état et ranime). À la fin de chaque combat, les héros obtiennent des PC (points de christalium), permettant de faire évoluer l’un des domaines, sachant que seuls trois domaines sont disponibles d’origine (en fait un seul même, mais les deux autres « natifs » se débloquent vite) et font vraiment évoluer le personnage rapidement, les trois autres domaines demandant un coût en PC astronomique pour des bonus risibles, sans compter l’efficacité bridée. Mais de toute façon, les stades d’évolution se débloquant de manière échelonnée, le jeu nous force presque à améliorer chaque domaine à la suite. Belle connerie, il faudra attendre la fin du jeu (après générique) pour débloquer le dernier stade d’évolution.
Autre élément déjà un peu plus intéressant, l’amélioration des équipements se fait par gain d’expérience en utilisant les objets laissés par les ennemis vaincus, mais ils servent aussi à obtenir des gills via les boutiques consultables par point de sauvegarde, car sinon les ennemis n’en laissent pas (comme dans le XII, sauf que le problème c’est que les butins servent ici). Du coup, on se retrouve constamment fauché, et dès l’accès au chapitre XI – délivrance qui nous fait sortir de ces horribles couloirs linéaires – mieux vaut se choisir une équipe et laisser moisir les trois autres. Donc voilà, plein de bonnes idées, majoritairement recyclées, mais l’équilibrage est un peu foireux et les vingt premières heures de jeu sont quasiment une succession de cinématique avec de temps à autre des QTE (actions contextuelles) lors des combats comateux. On fini par se laisser prendre au système de jeu, mais il est loin de faire honneur à la série, et le plaisir de jouer s’en ressent.
Durée de vie : 17/20
Quand on passe 20-25 heures enfermé dans des couloirs, accéder à Pulse et ses grandes étendues est un tel bonheur qu’on se doit d’y tester au moins une vingtaine sur les 64 missions accessibles (même si dix d’entre elles ne sont pas réalisable sans avoir fini le jeu, le stade 10 d’évolution étant plus qu’obligatoire). Et puis le boss de fin est tellement dur qu’y aller sans une préparation de mastodonte serait pure folie. Ainsi, si dans l’absolue le jeu peut être fini en 45-50 heures, mieux vaut tabler sur un peu plus de 60. Et pour venir à bout de toutes les missions et obtenir le meilleur arsenal, on peut gonfler ce chiffre à 80. Rien à voir avec la somme hallucinante de contenu hors trame de son prédécesseur, mais c’est déjà énorme et l’envie de s’y attarder n’est pas si forte.
Bande son : 16/20
Par soucis de compréhension, j’ai opté pour les voix anglaises. Elles sont d’un niveau classique, c’est-à-dire pas honteux mais assez caricatural quand même. Les musiques du jeu sont elles un peu moins classiques, proches de l’électro-pop, du dynamisme bien senti qui colle parfaitement avec l’univers. Exit donc les mélodies envoûtantes, mais au moins ça change. On notera quelques unes chantées, notamment « Chocobo of Cocoon », délire bien sympa et terriblement entêtant.
Scénario : 10/20
Huit ans après FFX, Square-Enix replonge. La religion ne leur avait pas tellement réussi, et ici ils ont fait presque pire. Dans un univers pas très inspiré, puisant dans la mythologie habituelle, on nous ressort des conflits religieux entre deux types d’entités spirituelles : les Fal’Cie de Cocoon, planète en lévitation au dessus de celle des seconds Fal’Cie, ceux de Pulse. Pour mettre à bien leurs plans, ils sélectionnent des humains et les transforment en L’Cie, leur ordonnant d’accomplir une tâche. Si ils réussissent, ils deviendront des cristaux, avec la possibilité de se réveiller un jour si un Fal’Cie a à nouveau besoin d’eux. Mais s’ils échouent, alors ils deviendront des Ceith, monstres déchus. Et comme d’habitude, les héros – pas très intéressants d’ailleurs – sont liés depuis le début, et ils doivent sauver le monde. Une histoire qui se donne des airs ambitieux, mais qui se révèle au fond très basique, bourrée de clichés, et l’univers est mine de rien assez pauvre (point de races fantastiques, juste du religieux glauque et dépressif). Immense déception.
Note Globale : 13/20
Tant d’années de travail acharné pour ça ? Attendu comme le grand messie des RPG, le jeu est une démo technique brillante, quasi irréprochable sur le plan visuel, au contenu énorme, addictif, au style qui sonnait novateur, et à l’histoire qui avait l’air épique, mais le résultat est très décevant. Une fois passé la claque des graphismes et de la mise en scène très cinématographique, le constat est amer : le système de jeu est trop dirigiste, mal pensé, et offre un plaisir de jeu réduit. Les couloirs nous saoulent très vite, de même que ces héros qui improvisent dans un chaos très brouillon, et les failles de l’histoire nous sautent aux yeux inévitablement. La poésie et le charme des précédents Final Fantasy ne s’y retrouve que très partiellement, et l’univers est d’une pauvresse proportionnelle à la quantité d’artifices tentant de la cacher. Certes, dans l’absolu le jeu reste bon, mais compte tenu de l’héritage, le bilan est douloureux. Mais après tout Pulse est immense, et peut-être que les suites ont su rectifier le tir en inventant tout un autre univers caché. À voir, mais la prudence est de mise.