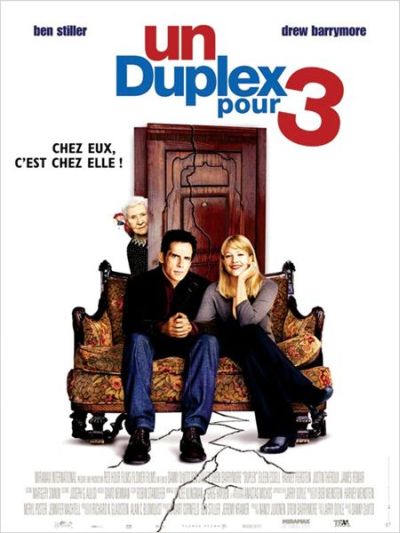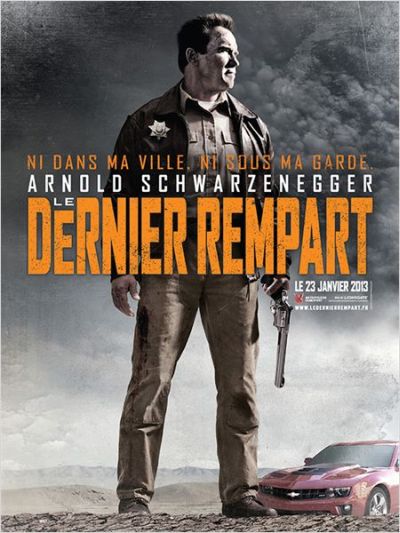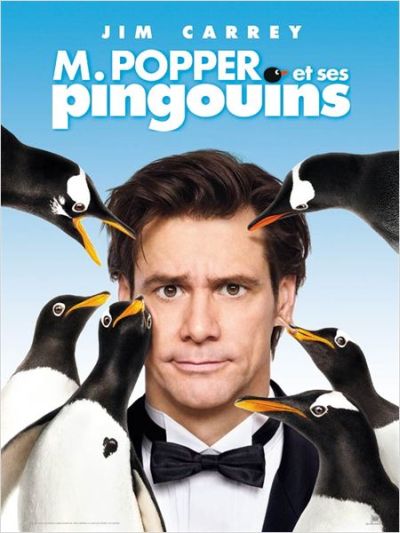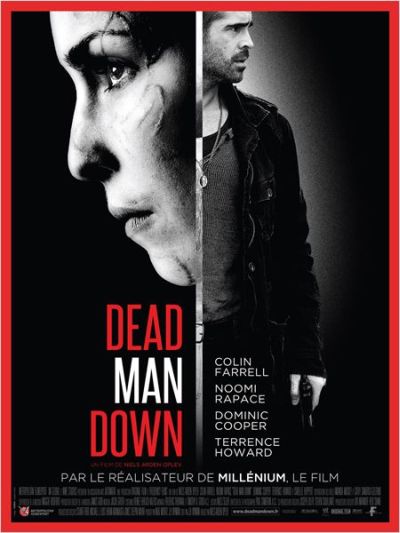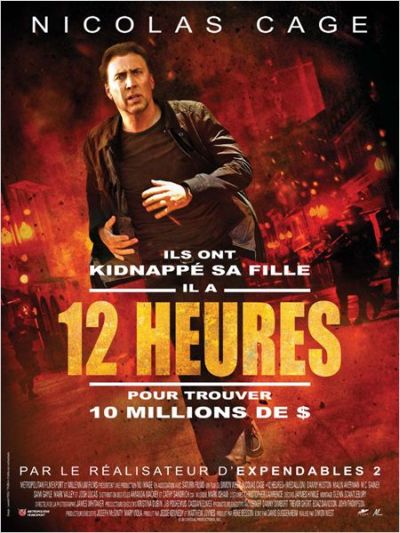22/11/63
2011
Stephen King
Tout le monde le sait – ou devrait le savoir du moins -, le 22 novembre 1963, le président des Etats-Unis John Fitzgerald Kennedy (JFK), a trouvé la mort, abattu dans sa limousine lors d’un passage à Dallas. Une tragédie terrible que l’immense romancier Stephen King va détourner de façon pas très originale (mais sait-on jamais ?) : et si sa mort avait pu être évitée ?
Gros pavé de 930 pages (plus sept pages de Postface où l’auteur s’adresse à nous pour expliquer le cheminement de son travail), le livre est divisé en 6 parties. La première nous place en compagnie de Jake Epping, un professeur de lettres dans un lycée à Lisbon, qui semble coresponsable de l’assassinat de JFK, tout cela parce qu’il a mit un A+ à un vieil homme au bord de la retraite souhaitant finalement avoir son diplôme : Harry Dunning. Pourtant, l’histoire est contemporaine. Un fait étrange, mais bien moins que sa visite chez Al, son ami qui tient une roulotte de fast-food : en l’espace d’une journée, il avait prit 5 ans, perdu 20 kilos, ses cheveux, ses dents, et gagné un cancer des poumons en phase terminale.
Aussi surréaliste cela peut il paraître, il semblerait que l’arrière du restaurant de Al soit un passage, mais pas n’importe quel passage : il conduit au 30 septembre 1958. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais c’est là, et après avoir fait l’expérience de passer de l’autre côté, c’est devenu une certitude pour Jake. Mais il y a une autre particularité : si tout ce qu’on fait dans ce passé a une influence réelle dans le présent, une fois revenu et si on retourne dans le passé, alors on se retrouve à nouveau en 1958 le même jour, et remplaçant la réalité alternative où la personne aurait déjà emprunté ce passage. Ainsi, on peut acheter à prix réduit les mêmes produits indéfiniment, mais pas y voyagé à loisir : le point est prédéfini. Néanmoins, si on choisit d’y rester, le temps s’écoule normalement et le passage du retour sera normalement toujours là, à moins que le cours des choses est modifié l’emplacement de Al et que son restaurant ne soit plus là en 2011. Un très grand risque donc, mais que Al a choisit de prendre. Conscient du caractère divin du pouvoir de changer le passé, il souhaitait s’en servir pour rendre le monde meilleur. Mais le point de départ étant invariablement 1958, empêcher les Guerres Mondiales est impossible, de même que le 11 septembre 2001 et l’élection de Bush, il faudrait rester plus de 40 ans dans le passé. C’est alors qu’une idée abordable et réaliste lui vint : sauver John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963, dont les répercutions bénéfiques seraient immenses selon ses études. Mais seulement voilà, la maladie l’a arrêté peu avant la date fatidique, et l’imminence de sa mort l’oblige à chercher d’autres options : Jake Epping, son vieil ami le professeur. Ainsi, dernière volonté d’un mourant, il va lui demander (page 76) d’accomplir cette mission à sa place.
Il y a pleins de théories sur la mort de JFK, et le livre va choisir l’une des moins crédibles d’entre elles : celle du tireur isolé Lee Harvey Oswald, une simple âme égarée dont le principal méfait avant l’assassinat était de battre sa femme. Pour l’aider à le convaincre, Al va parler à Jake d’une fille qu’il a sauvé d’un fauteuil roulant, mais dont le passage de Jake dans le passé a annulé ce sauvetage, preuve à l’appuie. Ainsi, il ne fait aucun doutes que ce passage conduit vers le passé et qu’on peut modifier le cours du temps, même si une résistance mystique se fait sentir. Pour mieux s’en convaincre, Jake ambitionna de sauver son vieil élève Harry d’une boucherie qui le rendit orphelin et fils unique en octobre 1958. Pour ses voyages temporels, il sera désormais George T. Amberson, des papiers apparemment valides d’après Al, malgré les remises à 0. Il va lors suivre une piste à Derry où un homme déguisé en clown aurait tué son fils à coup de masse, faisant écho au futur coup de marteau (inspiration ?). Car oui, comment retrouver le père de Harry sans connaître son prénom ? Vu la propension de gens portant le nom de Denning, la tâche est ardue, surtout sans internet. L’enquête s’éternisera sur plus d’une centaine de pages, alourdie par des passages sans grand intérêt, tout cela retardant le vrai sujet du livre : l’affaire Lee Oswald / JFK (même si au final, Sadie est plus importante). Ainsi, on apprend que le père de Harry était un monstre bien avant cet événement, et qu’il a déjà décimé sa première famille, un homme y ayant perdu une sœur et un neveu, jamais vraiment cherchés dans cette ville de Derry où personne n’est très regardant. Un premier coup d’essai à moitié raté : cette nuit là, trois personnes y ont trouvé la mort, plusieurs autres ayant aussi été blessé gravement. Un bilan moins lourd que l’original, mais décidément, le passé ne se laisse pas facilement changer… Beaucoup de faits abondent dans ce sens, certains très étranges, comme l’écriteau de la canalisation endommagée à réparer pour dissuader les gens d’emprunter le chemin qui mène au terrier, toujours présent des années après. Et si le cancer de Al était un fait divin pour l’empêcher de changer fondamentalement les choses ? Revenu dans le présent, il constata que sa tentative de sauvetage fut un désastre : si Harry n’était plus boiteux ou déficient mentalement, il avait perdu la vie au Vietnam en 68. Son hésitation quant à passer les cinq prochaines années à tenter de sauver JFK ne fut que plus grande, mais voulant honorer son ami sur son lit de mort, Jake décida de se lancer dans l’aventure…
S’en suivra donc une série de sauvetage, de la famille Dennings de Derry à la petite Carolyn Poulin et bien d’autres, avec pour point de chute bien sûr l’assassinat présidentiel de Dallas, mais il faut savoir laisser le suspense au lecteur, car à partir de la page 317 commence la partie d’ombre du livre, l’intervalle qui sépare les sauvetages personnels de celui de JFK, qui est loin d’être garanti. Exit George Amberson l’agent immobilier, il sera écrivain, donnant tout son sens au style narratif du livre, Jake en étant l’auteur. Il reviendra aussi à son travail de toujours, professeur d’anglais au lycée, mais ça c’est une autre histoire parsemée d’embûches et d’amour (bien que Al l’ai mit en garde contre ce fléau) mais aussi de coïncidences pas si fortuites. Si le second voyage dans le passé fut une période assez creuse du livre avec la première visite de Derry, la partie sur Sadie, la surveillance de Lee Oswald et l’expérience au lycée est encore plus molle, le présent semblant tellement loin et le chemin le séparant du 22 novembre 1963 (page 795) paraissant encore plus distante. Le livre connaît quelques moments de grâce avec la romance naïve mais franche entre George (Jake) et Sadie, mais cela nous éloigne du propos. Mais avec l’année scolaire 62-63 qui marque son détachement de la vie en société pour se concentrer sur Lee Oswald, les choses semblent s’accélérer, surtout qu’une date buttoir plus proche se dessine : celle du 10 avril 1963 (théorie évoquée page 504, mais le jour j n’arrivera que page 627, du moins aurait dû…). George de Mohrenschildt, clef de voûte de la culpabilité d’Oswald avec l’affaire du général Edwin Walker.
Avec sa cinquième et avant-dernière partie, portant le titre du livre, on entre dans la dernière ligne droite de l’ultime confrontation, bien qu’un certain incident retardera quelque peu – beaucoup – les choses. De manière générale, la relation entre Jake et Sadie met du piment à l’histoire, il y a même de grandes envolées, mais il est regrettable que cela prenne à ce point le pas sur l’histoire de base, rallongeant artificiellement le livre, nous faisant régulièrement rager tant il ne tient pas assez compte de Carton (nom donné à un personnage qui représente le phénomène de résistance temporelle sur la modification du passé). Et effectivement, on commence à appréhender la fin entre le passé tenace et la folie qui s’empare de Jake. Puis vient la conclusion, facile en apparences, jusqu’à la visite de l’homme carton (page 878), remettant un peu les choses à leurs places. Sans faire preuve d’un génie absolu, l’écrivain arrive néanmoins à expliquer tout ce qui se rapporte aux réalités alternatives et aux voyages temporels, éclaircissant bon nombre de points et rendant le tout cohérent, une qualité fondamentale. Fort d’un raisonnement solide donc, il nous livre une fin plutôt réussie, bouclant la boucle, malgré un certain pessimisme et une vision sombre de notre monde.
Ainsi, le livre nous conte l’histoire de Jake Epping, une histoire historique qui a un peu tendance à tomber dans les travers du sentimentalisme ou du politiquement correct, et dont la longueur excessive enlise par moment le lecteur dans un trop-plein de redondances (notamment avec ce qui entoure la surveillance de Lee Harvey Oswald) amenant l’ennui passager, mais le livre parvient sans problème à nous captiver. Si la base du voyage temporel prétexte à sauver le président John Fitzgerald Kennedy d’une mort programmée au 22 novembre 1963 est discutable, son application donne lieu à une base solide en terme de raisonnement. De plus, l’histoire connait de nombreuses envolées de qualité, redonnant de très utiles coups de boost à la narration. De plus, le style du livre ravit de par son accessibilité et sa clarté, cherchant plus à servir l’histoire que l’ego de l’écrivain. Ça n’est clairement pas le livre le plus abouti de Stephen King, mais son titre de maître de suspense n’est pas surfait et il le prouve une fois de plus dans cet exercice singulier et enrichissant.

Cet article est dédié à mon frère, dont c’est l’anniversaire, et qui m’avait offert le livre il y a quelques mois de cela.