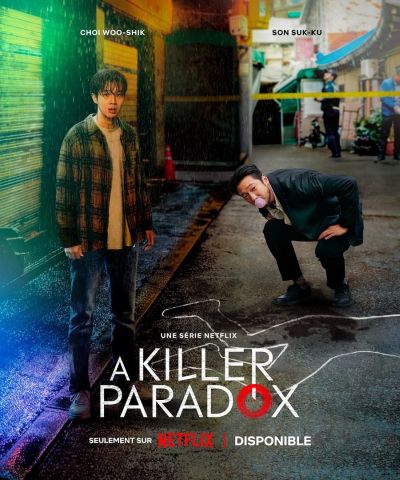La Traque dans le sang – Saison 1
2023
Joo-hwan Kim
On continue de poncer le catalogue Netflix des séries sud-coréennes avec une nouvelle fois un grand succès dans le genre thriller / action, y ajoutant cette fois des éléments de budy moovie / bromance à la sauce boxe. Et une fois n’est pas coutume, ce ne sera pas un one-shot mais bien une première saison, une suite ayant été tournée à l’automne 2024 pour une sortie fin 2025 / début 2026.
La passion, ça rapproche. Après s’être affrontés sur le ring, Jin (Lee Sang-yi) et Woo (Woo Do-Hwan) vont avoir un coup de foudre amical et ne plus jamais se séparer. Profitant de la crise du Covid pour arnaquer les petits commerçants en situation de crise financière, un groupe appelé Smile Corp va s’en prendre au café de la mère de Woo, incapable de rembourser. Les deux amis boxeurs vont alors s’engager chez monsieur Choi, un bienfaiteur qui va racheter la dette du café.
Il faut bien avouer que cette série est une claque sur au moins un point : les chorégraphies. Dès le premier épisode, on est sur le cul face à ce qui est sans nulle l’une des scènes de baston les plus jouissives et abouties jamais vue. Du 1 Vs 20 réaliste, ultra dynamique, bourrin mais jamais illisible, une maestria de réalisation et de chorégraphie de combats. L’histoire de mafia / organisation du crime est assez approfondie à défaut d’être originale, et l’écriture des personnages est vraiment excellente, notamment les deux frères d’armes qui sont vraiment attachants. En revanche, impossible d’ignorer Joo, incarnée par la regrettée Sae-Ron Kim, poussée au suicide par la presse à seulement 24 ans à cause d’une histoire de conduite en état d’ébriété. Personnage initiateur de cette justice de l’ombre, cœur de la série, elle sera éjectée comme une malpropre en fin d’épisode 6, pour être remplacée par un personnage fonction clone qui sent fort la réécriture de dernière minute, avec son lot de déceptions. Et comme pour la quasi totalité des séries sud-coréennes vues jusqu’à présent, on a encore et toujours cet éternel dérapage de dernière ligne droite, où soit le concept ne tient pas la longueur, soit la cohérence globale est sacrifiée sur l’autel d’une pseudo originalité malvenue et mal amenée. Cette fois c’est plutôt un souci de petits bras, nous balançant un ignoble bain de sang, et la soif de vengeance du spectateur ne sera pas récompensée, la fin étant assez petite en termes d’ampleur. Clairement, la riposte semble disproportionnée, dans le mauvais sens. On retiendra donc des chorégraphies épatantes, surtout dans les premiers épisodes, et une dynamique forte entre les personnages, notamment les frères de cœur qui sont la grande force. Reste à savoir s’ils suffiront à justifier une saison 2 qui laisse potentiellement dubitatif.