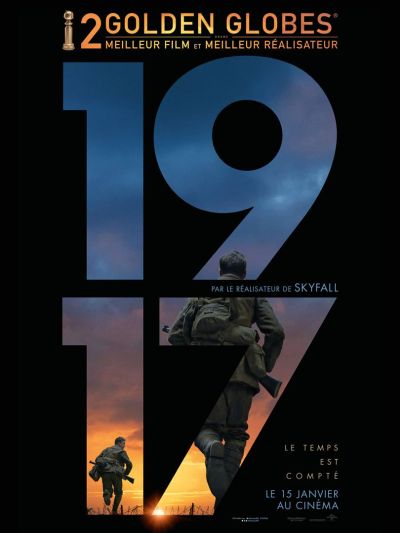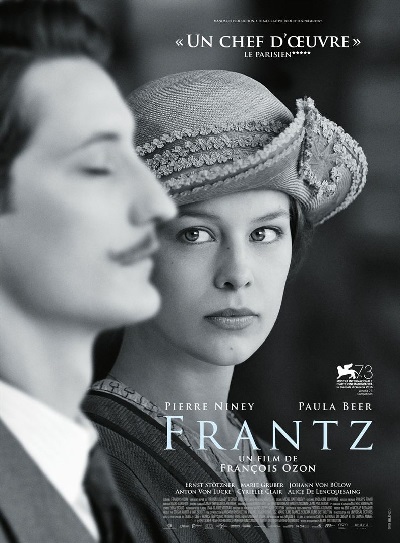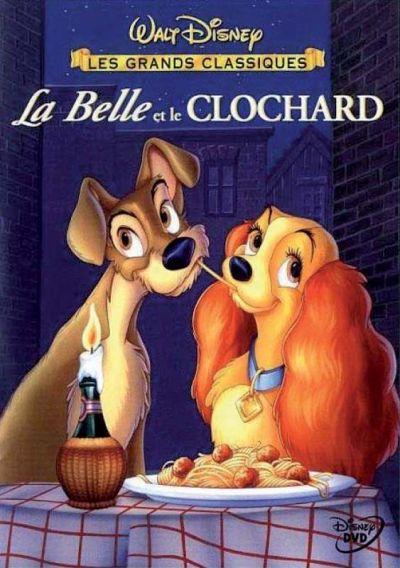Dragons 3 : Le monde caché
2019
Dean DeBlois
Trois ans avant la série Vikings qui a fait des mythes nordiques le nouveau thème à la mode, et quatre ans avant que Oultander n’achève de faire prendre conscience que les musiques écossaises sont une tuerie, une petite pépite de l’animation a mélangé ces deux viviers avec une créature magique, source de tous les fantasmes et qui lui a donné son nom : Dragons. Quatre ans plus tard, Dragons 2 prolongea l’aventure avec brio, proposant des moments sacrément épiques. Alors que la conclusion de la trilogie devait sortir en 2016, la production de diverses séries annexes, des résultats au box-office solides mais pas transcendants et des soucis de distribution (chacun des trois films fut distribué par un studio différent), il aura finalement fallut attendre cinq ans pour enfin voir débarquer l’ultime chapitre de cette histoire.
Le récit se place quelques années après que Harold soit devenu le nouveau roi de Burk, et les problèmes s’enchaînent. Loin d’être le paradis espéré, leur île devient une zone de convoitise pour leurs dragons, les chasseurs se multiplient et les ennemis deviennent de plus en plus dangereux. Face à une coalition massive, la situation semble désespérée. Harold va alors prendre la décision d’évacuer tout le village et de partir à la recherche du monde caché où les dragons pourraient vivre paisibles.
Métaphore du passage à l’âge adulte, cette saga poursuit sa logique. Après avoir affronté ses peurs et essayé de vivre ses rêves, Harold doit maintenant apprendre à vivre sans et accepter certaines fatalités. L’ennemi à affronter est assez charismatique, mais au final on ne saura pratiquement rien de lui, et il ne marquera pas autant que les dragons géants des précédents opus. Autant le premier était la découverte et le second le souffle épique de l’aventure, cette fois il n’y aura pas cette même fougue, le film rattrapant le train de la réalité pour conclure l’arc de façon crédible, presque historique. Il ne pouvait en être autrement vu les partis pris, tout en conservant cette aura si particulière de désir d’évasion, ponctuée par des musiques sublimes. Le monde caché et la découverte du Furie éclair permettent de maintenir le rêve, et quelques idées critiques sur la superficialité sont amusantes, comme par exemple Rustik, plus grand et costaud des jeunes, est devenu à force le plus petit, ou encore la quête de virilité passant par la pilosité faciale. Malgré une nouvelle baisse de budget, le film est toujours aussi beau et enchanteur, arrivant à trouver de nouvelles façons de nous éblouir. Si globalement le renouvellement est limité et que l’histoire aurait mérité plus d’envergure, on peut se satisfaire d’une qualité toujours aussi grande. Certaines saga s’effilent et ne font que trop durer. Ici, tout en laissant la porte ouverte aux rêves, l’histoire est achevée et on part sans regrets.
Bon et maintenant oubliez tout ce que je viens de dire. Il y a quelques semaines est sorti un court-métrage de l’univers à l’occasion de Noël. Si les séries dérivées et la plupart des courts issus de la saga étaient oubliables, quelque uns étaient très bons, et Homecoming en fait partie. Racontant comment tragiquement les nouvelles générations ne croient pas en l’existence des dragons, Harold décide de mettre en place, pour ses enfants et ceux qui ont oublié, un spectacle en mémoire à cette amitié homme-animal. Aussi touchant qu’émouvant, on découvre la tristesse d’un monde sans dragons, et jusqu’à la fin la frustration domine. Outre les absences de la mère et de Rustik parmi les principaux, de voir la séparation des mondes est un crève-cœur. Seulement un détail pourtant logique nous échappe : l’intrigue se situe juste avant la toute dernière scène du troisième opus. Un hourra se fera alors ressentir, changeant même notre vision fataliste de ladite scène, faisant dire que d’autres suites restent possibles, voir souhaitable tant cet univers est un enchantement perpétuel.