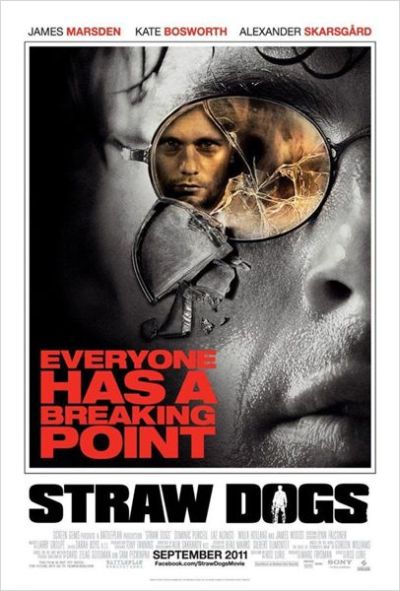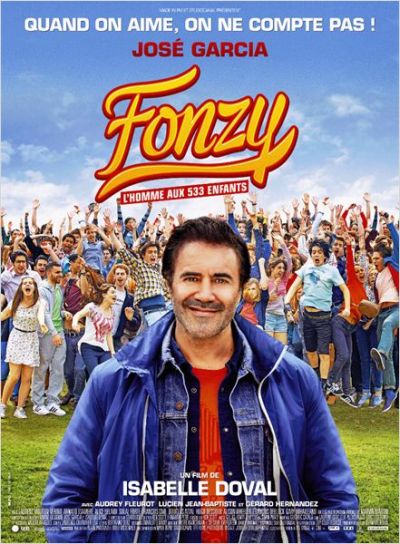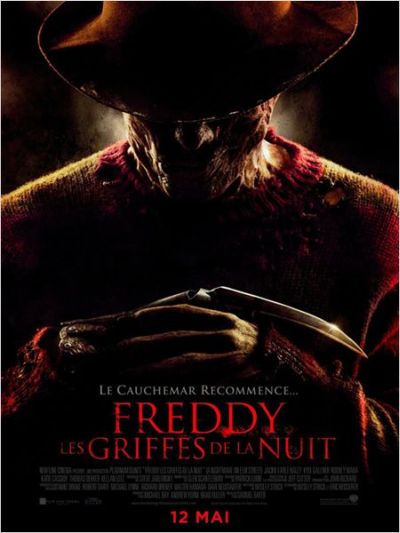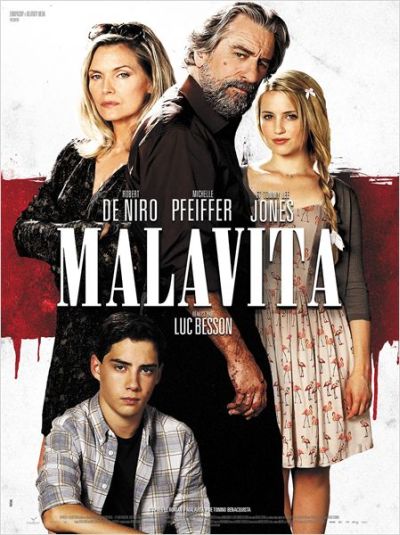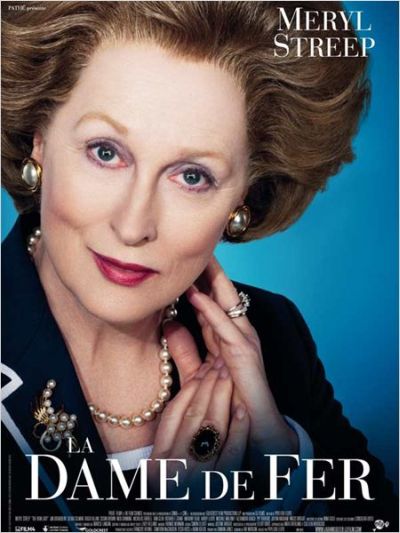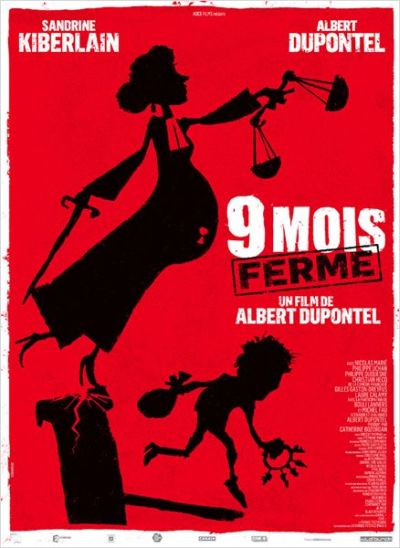Trop souvent, les jeux de combat ne se résument qu’à des combats en arène où les personnages se font face, piégés sur des railles en deux dimensions, même si les graphismes s’affichent parfois en 3D. Une hérésie archaïque qui a certes fait les beaux jours des bornes de jeu et des vieilles consoles, mais on se lasse quand le procédé est réutilisé sur des plateformes récentes. Mais de temps à autre, un Budokai Tenkachi vient un peu bouleverser l’équilibre des choses, nous faisant espérer pareille réussite dans ce qui s’annonçait comme des affrontements épiques en compagnie des plus grandes figures de Final Fantasy, mais la réussite de ce fan service célébrant avec un peu de retard les 20 ans de la saga ne sera pas aussi flamboyante.
Graphismes : 15/20
Rarement une console ne se sera montrer aussi décevante. Si encore une fois Square Enix nous livre une belle performance visuelle, quoique légèrement moins probante que sur Kingdom Hearts ou Crisis Core, l’éblouissement et l’émerveillement n’auront jamais atteint la portable de Sony, éternellement cantonnée à afficher des personnages fins dans des décors désespérément vides. Une belle direction artistique, des effets lumineux omniprésents et des attaques spéciales impressionnantes : il a tout de même beaucoup de travail réalisé d’autant que chaque personnage (et il y en a 22) possède ses propres attaques, et après une vingtaine de niveau un caractère dantesque prend le dessus, mais rien de véritablement bluffant. À côté de ça, les arènes sont peu nombreuse (treize, dont certaines injouables) et la plupart ne sont pas assez détaillées ou trop pixelisées.
Jouabilité : 12/20
Voilà une note qui peut paraître, abusive, mais il faut tout de même lourdement sanctionner les innombrables défauts du jeu tant ils peuvent être insurmontables par moments. Des affrontements aériens ultras dynamiques basés sur un système proche du RPG avec des personnalisations à gogo donnant lieu à l’un des jeux de combat les plus technique de l’histoire, c’est grisant, mais tout n’est aussi extraordinaire. Premièrement, pour profiter un tant soit peu du jeu, il faut monter au moins au niveau 20-25 son personnage, et même aller jusqu’au lvl 100 pour pleinement saisir le potentiel de chaque personnages. Si on peut modifier les paramètres de la console pour obtenir les bonus du jour spécial et ainsi booster sa progression, le mode histoire aboutira à un constat douloureux : sur les 22 personnages, seuls 10 atteindront le niveau 20 dont un seul pour le 100°. Pourquoi ? Parce que les méchants ainsi que les deux personnages bonus n’ont pas le droit à leur histoire et il faut alors passer par les autres formes de combat pour les faire évoluer : une tâche longue et fastidieuse.
On pourra aussi parler des équipements de haut niveau très difficiles à obtenir, ou même le hasard total concernant les bonus PA dans la campagne tant l’IA peut se montrer détestable et anti-jeu, mais les principaux problèmes ne sont pas là. Il y a déjà le soucis des arènes, certaines n’étant tout simplement pas jouables : celles en terrain clôt. Une caméra qui se bloque dans un coin, un ennemi invisible, un système de look affolé : avec des affrontement potentiellement pliés en moins de cinq secondes, on aura vite fait de mourir une centaine de fois face à certains ennemis de catégorie ultime. En effet, dans le mode « scénario », certains ennemis possèdent un niveau IA démentiel, généralement accompagné par un haut lvl. Avec à niveau égal une puissance cent fois supérieure (atteignant même un rapport de force de 1/1000 pour le niveau suprême) et une aptitude permettant de survivre à toutes attaques tant qu’il leur reste plus d’1PV, on atteint un taux d’échec quasiment imparable tenant uniquement à une chance miraculeuse.
Autre problème de taille : la différence monstrueuse entre les personnages. Si certains comme Furion (FFII) ou Terra (FFVI) sont presque intouchables ou d’autres comme Squall (FFVIII), Cloud & Sephiroth (FFVII) disposant d’une vitesse décisive, ou encore Gabranth (FFXII) et sa recharge abusive d’EX (qui permet d’utiliser à l’infini son coup ultime), d’autres sont des inutiles en puissances, massacrés en deux secondes, comme Djidane (FFIX) et Cecil (FFIV) avec leurs précisions ridicules, ou Exdeath (FFV) et ses déplacements chaotiques. Des invincibles et des boulets : un équilibrage catastrophique.
Durée de vie : 19/20
Effectivement, surtout pour un jeu de combat, difficile de soutenir la comparaison : après une petite intro, dix campagnes pour une durée de 12-15 heures, suivie par une seconde campagne de quatre chapitres et trois autres bonus, on amène le total à du 20-25 heures. Et encore, ça ne reste que la partie scénarisée, à laquelle on rajoutera plusieurs modes de jeu solo ou multi, avec aussi une certaine rejouabilité des campagnes pour les aficionados du 100%, même si le hasard empêchera cette potentialité tant l’IA peut se montrer farceuse (une condition de victoire en moins de 10 secondes pour les PA et un adversaire qui fonce dans la direction opposée et paf, c’est déjà perdu). Il y a aussi potentiellement la montée en niveau des personnages, mais comme la plupart n’en valent pas la peine… Et puis il ne faut pas oublier qu’une grosse partie du temps passé à jouer sera perdu dans des défaites aussi nombreuses qu’inévitables, le choix de difficulté saisie dans le jeu n’étant en fait qu’une erreur de programmation pas prise en compte.
Bande son : 14 /20
Encore une fois, cette note peut paraître sévère, mais elle ne remet pas en compte les magnifiques musiques de la saga mais bien leur nombre, bien trop léger. Avec seulement une ou deux musiques par jeu estampillé Final Fantasy, on tourne vite en boucle, et ce n’est pas le thème original de celui-ci qui fera la différence. De plus, on regrettera de na pas avoir droit à un doublage français (notamment pour FFVII qui fait figure de modèle avec Advent Children), surtout aux vus des piètres performances anglaises.
Scénario : 2/20
Soit on en fait pas, soit on joue le jeu à fond. Pourtant responsable bon nombre des meilleurs scénario de l’histoire, Square Enix se vôtre méchamment quant à rassembler tous ses personnages emblématiques. Pourtant appuyée par de sublimes cinématiques (à condition d’avoir utilisé l’option d’installation du jeu, sans quoi ces dernières seront saccadées), l’histoire n’est qu’une farce indigne, ne rendant ni hommage aux héros ni à leurs ennemis, les montrant tous comme des faibles à la psychologie risible. Une désacralisation regrettable et hautement décevante, qui dans la pratique n’est qu’un blabla interminable pseudo philosophique sur la vie et l’amitié. Décidément, en plus des graphismes, la console est aussi une déception continue en matière de scénario.
Note Globale : 13/20
Square Enix qui tente de mêler son style RPG classique des Final Fantasy à l’univers des jeux de combats. Un jeu improbable en remerciement aux fans, très alléchant sur le papier : un jeu de combat épique en compagnie de nos héros préférés. Initialement prévu sur Playstation 2, le portage se fit dans la douleur. Clairement pas pensé pour une console à petit écran et ne disposant pas de stick de contrôle de la caméra (les flèches ne pouvant assurément pas être utilisées en simultané du stick de déplacement), toutes les arènes en endroit fermé ou partiellement fermé est immédiatement sujet à des bugs, des morts inévitables qui nous font pester. Malgré un système de combat très élaboré et jouissif, ajoutant avec ingéniosité le système de RPG classique, le jeu échoue lamentablement lorsqu’il s’agit de doser la difficulté ou l’équilibre des forces entre les personnages. Des rapports de forces improbables, une IA impitoyable et un mode campagne inintéressant au possible : la progression dans le jeu est douloureuse et l’échec est une fatalité. Extraordinaire en théorie mais trop rarement en pratique, le calibrage ruine l’expérience du joueur. Bourré de qualités, le jeu n’en reste pas moins une amère déception.