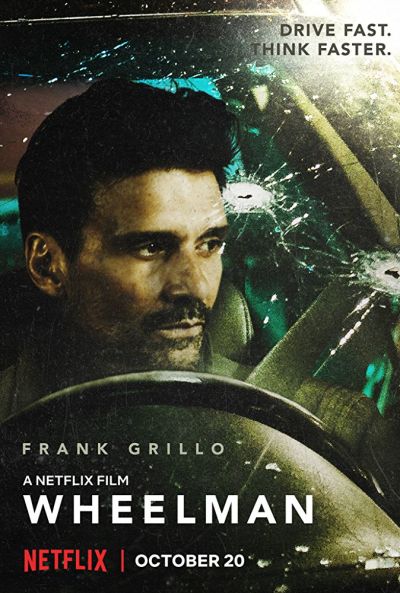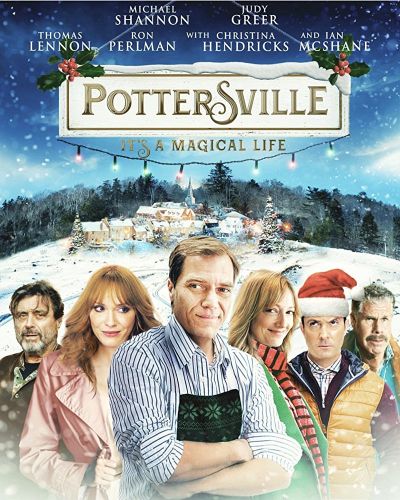Santa & Cie
2017
Alain Chabat
Dans les années 90, on avait deux groupes comiques qui fédéraient quasiment tout le monde : Les inconnus et Les Nuls. Figure emblématique de ces seconds, Alain Chabat a toujours occupé une place de choix dans nos cœurs de petits français, et ses trois premiers films en tant que réalisateur sont devenus cultes. Seul son quatrième long-métrage a laissé globalement perplexe : Sur la piste du Marsupilami, quoique moins honteux que ce qu’on aurait pu craindre. Loin de nous refroidir, on attendait tous son prochain projet comme des enfants attendant leurs cadeaux de Noël, et c’est justement sur cette fête que le film porte.
Dans le film, Alain Chabat y campe Santa Claus, le Père Noël, devant faire face à un énorme problème : à une poignée de jours de Noël, ses 92 000 lutins vont tous tomber malades simultanément. D’après sa femme Wanda (Audrey Tautou), ils manqueraient de vitames C, et il faudrait donc se rendre en territoire civilisé pour commander près de cent mille vitamines pour les remettre sur pied. Un challenge difficile quand on ne connaît pas le monde qui nous entoure, mais il trouvera sur sa route Thomas (Pio Marmai) et sa femme (Golshifteh Farahani) qui vont accepter de l’aider dans sa tache.
Les films de Noël occupent une part de moins en moins important d’année en année, surtout en France où même les grosses comédies américaines sur le sujet ont des sorties confidentielles voir directement dans les bacs. Un gros blockbuster français avec un artiste au capital sympathie dingue, ça nourrissait forcément des attentes considérables, et dans ces conditions là on ne peut qu’être déçu si le film n’est pas au minimum excellent. Enchaînant les jeux de mots faciles et débiles sans être drôles pour autant, lâchant du guest pour les prestige sans rien en faire derrière, à l’image du duo David Marsais et Grégoire Ludig carrément sous-exploité, le film coupe rapidement court à nos attentes. Le scénario est au mieux bancal, reposant sur une idée très faiblarde et multipliant les incohérences. La plus flagrante est celle de l’argent : Santa prétend être l’inventeur du monopoli, et pourtant il ne comprend pas la notion d’argent, achat et vente. L’écriture des personnages est elle aussi problématique tant la psychologie de chacun ne bougera pas, même celle du Père Noël qui restera un connard narcissique quasi autiste jusqu’à la fin. C’est dommage car le film avait un vrai potentiel et quelques trouvailles s’y sont glissées. On pense notamment aux pouvoirs du Père Noël, capable de parler n’importe quelle langue au monde et il connaît et se rappelle de tous les enfants et de tous les cadeaux qu’il leur a apporté. Cela donne lieu à quelques scènes tantôt drôles tantôt touchantes, mais trop peu nombreuses pour tirer pleinement parti du potentiel sous-jacent. Au final le film est tout juste correct, pas si drôle que ça et largement plombé par l’inconsistance de son histoire. Un crève cœur tant on voulait y croire.