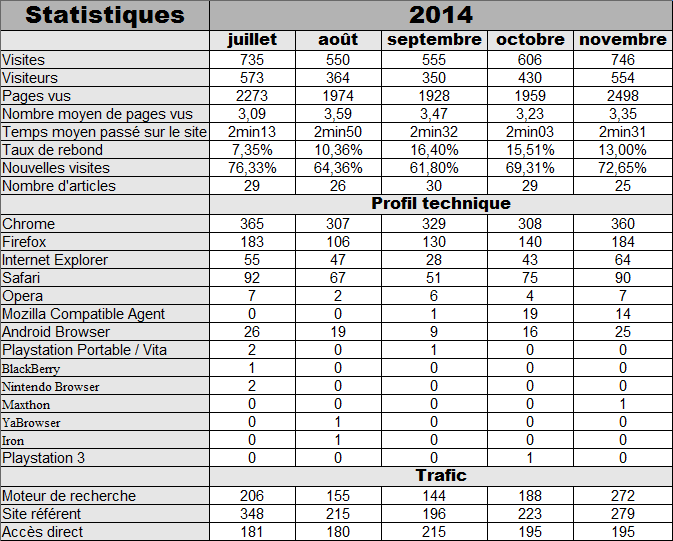Californication
2007 – 2014
Tom Kapinos
Après Dexter, la célèbre chaîne câblée américaine Showtime perdait sa seconde meilleure série en terme d’audience le 29 juin dernier après une septième et dernière saison qui marquait effectivement le déclin de la série, divisant par deux sa moyenne de fréquentation par rapport à la saison précédente. Les gens se sont-il lassé de voir Hank déconner à ce point ? Triste sort pour la série qui a tutoyé les deux millions de spectateurs à sa grande époque, tombant sous la barre du million pour ses deux dernières saisons, et s’achevant devant moins de quatre cent mille personnes. Y a t-il eu une réelle baisse de qualité sur la fin ? Rien n’est moins sûr, mais il est l’heure de rendre hommage à l’un des plus grands héros tragique de l’histoire de la télévision.
L’aventure démarra donc le 13 août 2007, alors que l’immense agent Fox Mulder des X-Files faisait son retour triomphal à la télévision avec un rôle en opposition total avec celui du gentil, naïf et réservé agent du FBI (l’occasion d’un petit tacle à ce sujet en saison 4 d’ailleurs). David Duchovny campe ici un certain Hank Moody, écrivain maudit auteur d’un unique succès : « Dieu nous hait tous », dont l’adaptation cinématographique, « Cette petite folie qu’on appelle l’amour », le désespère au plus haut point tant c’est – à ses yeux – une infâme bouse hollywoodienne. Cela fait des années qu’il n’arrive plus à écrire – en fait depuis qu’il a emménagé à Los Angeles – et tout dans sa vie va mal. Il est une déception constante pour sa fille Rebecca (Madeleine Martin) et le doux rêve de renouer avec l’amour de sa vie, la mère de sa fille, Karen (Natascha McElhone), ne sera bientôt qu’une lointaine chimère, étant promise à un autre. Pour oublier sa situation merdique, il se réfugie dans l’alcool, les drogues, et tout spécialement le sexe. Voilà donc le genre d’homme qu’est Hank, grand dépressif et nostalgique, assez largement inspiré du célèbre film Manhattan, de par le style, le nom du héros (Moody / Woody) ou même modèle de voiture, identique.
La première saison pose les bases, montrant donc principalement Hank, sa femme, sa fille, mais aussi Charlie Runkle (Evan Handler), l’agent et meilleur ami de Hank, et sa femme Marcy la schtroupfette (Pamela Adlon), ainsi que Mia (Madeline Zima), la fille de Bill, nouveau prétendant de Karen. Mia constitue un peu la pierre angulaire de la trame de la première saison : c’est par elle que tout arrive, que tout part en vrille. Alors que Hank ignorait totalement son existence, elle va le séduire, puis coucher avec lui. Un fait anodin si seulement elle n’était pas la fille de son concurrent et si elle n’avait pas 16 ans, constituant là un détournement de mineur. Une épée de Damoclès pour lui, un petit jeu diabolique pour elle. Elle en profitera pour lui extorquer son miraculeux nouveau roman, uniquement en possession de Mia suite à une série de malchances dont Hank a le secret. Entre ça, la tentative désespérée de Hank pour renouer avec Karen, et les déboires des Runkle, prit au piège de la secrétaire de Charlie venue s’immiscer dans leur couple, l’histoire de cette saison est plutôt discrète, nous montrant sous diverses formes les vices et les faiblesses d’un héros au grand cœur, mais brisé. Des prémices de concept, suffisant pour significativement accrocher, notamment grâce à un David Duchovny empathique et brillant dans son genre. Une ébauche assez professionnelle et au fort potentiel.
Saison 1 : 

Sacré choc, la séquence de fin de la dernière saison était classe, mais on attendait au tournant la suite des événements. Servir sur un plateau le rêve absolu de Hank, à savoir le retour de sa femme qu’il n’a jamais épousé, c’était effectivement une belle chose, mais c’était probablement trop tôt. Alcoolique, fumeur, dépressif et tombeur : voilà comment on l’aimait. Le tir sera donc rectifié dès le premier épisode avec un accident qui débouchera sur d’autres conneries, amenant à une rupture aussi prévisible que pénible. Ah c’est malin de les remettre ensemble pour une petite poignée d’épisodes ! Du coup, la série n’évolue pas et continue de faire ses choux gras dans les mêmes moules. Quelques pistes intéressantes malgré tout avec le premier petit copain de Becca (Ezra Miller), les nouveaux déboires du couple Charlie / Marcy avec l’arrivée d’une actrice porno qui deviendra la maîtresse du bouddha miniature, et surtout Lew Ashby (Callum Keith Rennie), le premier vrai pote de Hank avec qui il partage nombre de similitudes. Un vrai bon personnage, attachant et mystérieux, qui relance à lui seul l’intérêt de la série. Globalement on stagne et la trame de la saison n’a rien de mémorable, mais au moins la qualité est maintenue et le potentiel reste intact.
Saison 2 : 

Un couple se brise, un autre se reforme, partiellement. La dernière connerie de Charlie lui a coûté son mariage, et Hank devait se remettre avec Karen, mais cette dernière est partie pour son travail à New-York, laissant son abruti d’amant avec une carte blanche, qu’il ne manquera pas d’utiliser sans se soucier des conséquences, pensant comme d’habitude uniquement au plaisir qu’il donne à toutes ses femmes en leur montrant à quel point elles sont belles et uniques. Une nouvelle saison très intéressante à diverses niveaux. Charlie se remet enfin en scelle et retrouve un poste de manager (chez Kathleen Turner), tandis que Hank, malgré l’absence de publication de ses mémoires de Lew Ashby, se range et devient professeur, probablement son occupation la plus pertinente et la plus saine. Seulement voilà, vouloir faire plaisir à son assistante, à son étudiante préférée et à la femme du doyen (Embeth Davidtz), ça ne sera pas sans conséquences : lors d’un huitième épisode magnifique, l’ensemble lui retombera sur le coin de la gueule dans un déluge biblique. Le héros maudit dans toute sa splendeur : il n’a, au fond, rien fait de mal, mais chacun de ses actes va avoir une répercussion désastreuse sur sa vie. Et certaines malchances du passé vont elles aussi resurgir pour un final quasi comique tant Dieu semble le haïr. Son roman « Dieu nous haït tous » s’applique particulièrement à lui. Les personnages sont donc quelque peu malmenés, et c’est avec un plaisir machiavélique qu’on assiste à leur déchéance. Un humour plus acerbe, une ambiance plus aboutie, une mise en abîme plus poussée : la série a trouvé sa voie.
Saison 3 : 
Ça y est : Hank est au fond du trou et la merde commence à suinter par tous les orifices. Vieille épée de Damoclès oubliée depuis longtemps, la petite aventure d’un soir entre lui et Mia va lui retomber dessus avec une violence inouï : non seulement cela a brisé sa famille et fait de lui un pédophile aux yeux du monde entier, mais en plus il risque une lourde condamnation pour détournement de mineur. Au moins ce drame a permis de réparer une injustice de taille : Hank est désormais officiellement l’auteur de « Fornication Musclée », même si on a toujours au travers de la gorge l’absence de publication pour les mémoires de Lew Ashby. On le retrouve donc dans notre position favorite : celle du pauvre type malchanceux qui a besoin de boire pour soulager sa douleur. Et avec son statut de monstre auprès de sa progéniture et de celle qui a aidé à la concevoir, ce besoin sera décuplé, au point de finir à l’hôpital dès le second épisode, d’abord perçu comme une tentative de suicide faisant remonter sa côte de popularité. Un passage assurément très fort, à la fois symbolique, incroyablement drôle et dramatique. Cette quatrième saison est principalement axée autour du procès de Hank donc, mais pas que. L’adaptation cinématographique de son livre est aussi au cœur de l’intrigue avec Sasha Bingham (Addison Timlin) et Eddie Nero (Rob Lowe), de grands acteurs censés l’incarné lui et Mia à l’écran. Ainsi, on vit pour de vrai l’expérience retracée au travers de flashback sur sa première adaptation au cinéma. De son côté, Charlie essaye de se la jouer comme Hank depuis sa liberté retrouvée, une comparaison assez drôle tant les deux ne boxent pas du tout dans la même catégorie. Tant qu’à Marcy, elle batifole avec un riche producteur, Stu (Stephen Tobolowsky). Des péripéties intéressantes, pleine de nouveaux personnages très bons comme l’avocate (Carla Gugino), et l’intensité de la série est à son paroxysme.
Saison 4 : 

Gros bond dans la série, la cinquième saison démarre trois ans après la fin de la dernière qui voyait notre romantique-dépressif écoper de trois ans avec sursis et un nombre conséquent d’heures de travaux d’intérêts généraux. Les choses ont donc beaucoup changé depuis le temps : Marcy et Stu file le grand amour, et leur enfant qu’ils partagent avec Charlie a deux ans et demi. Becca est à l’université et sort avec une version jeune de son père, tandis que Karen a refait sa vie avec son ancien amour et prof de fac Richard Bates (Jason Beghe, furtivement apparu en saison 3) et est désormais son épouse. Charlie sombre un peu plus, devenant le chien errant qu’était Hank, en quête de rédemption, non sans difficultés. Sa carrière reprend du poil de la bête entre son nouveau livre (« Californication », inspiré de ses déboires de ses dernières années) et un job de scénariste sur une grosse production Hollywoodienne, mais sa vie reste toujours aussi bordélique. Il a fait l’erreur de tourner autour de la copine de Samurai Apocalypse (RZA), celui pour qui il écrit le film, et son retour dans la vie de sa fille va être catastrophique tant son nouveau copain est un connard de première. Lui qui revenait sur des bases saines, prêt à refaire sa vie et voulant seulement aider son prochain, il va encore une fois avoir tout faux et foutre le même bordel dans un chaos imperturbable. Des situations pas très neuves voir quasi redondantes, heureusement relativisées par l’arrivée de très bons nouveaux personnages, et on sent la fin de la série poindre le bout de son nez, douce-amer au happy end difficile à croire. Pourra t-il éviter de finir mort dans une flaque de pisse ou de vomit ? Un dernier virage qui s’annonce difficile à négocier, en espérant que la série arrive à nous captiver jusqu’au bout.
Saison 5 : 
Il touchait au but : destination la terre promise avec Karen et Becca. Mais voilà, une ex complètement siphonnée, un verre contenant un cocktail mortel de médicaments, et c’est son rêve qui s’envole, prit au piège de ses éternelles conneries par inadvertance. Une spirale de l’auto-apitoiement va alors débuter dans un tourbillon d’alcool, obligeant ses proches à intervenir pour mettre fin à son comportement destructeur en l’envoyant en cure de désintoxication. Il y rencontrera la belle Faith (Maggie Grace), fille d’apparence très superficielle, d’autant plus en prenant compte son style de vie (elle se sert de son corps sublime pour se faire entretenir par des rocks-stars), mais sa romance avec Hank aurait pu être son unique chance de finir heureux, mais seul l’avenir nous le dira. L’intrigue de cette avant-dernière saison est principalement axée autour d’Atticus Fetch, chanteur rock déjanté, campé par un vrai rockeur probablement très similaire à son personnage tant il est convaincant. Cette fois, l’écrivain Moody est chargé de pondre une comédie musicale, exercice inédit mais à l’approche identique. Et c’est un peu le drame de cette saison qui commence à s’essouffler : malgré des situations différentes, rien n’évolue vraiment et on ne découvre plus rien. La plongée au cœur du milieu de la musique trash, c’était déjà le décors de la seconde saison, et le parallèle est d’autant plus flagrant avec le retour d’Ashby sous forme de conscience (on a d’ailleurs enfin la confirmation de la publication de ses mémoires !). Hank est toujours hanté par Karen, Charlie replonge vers Marcy et Becca continue de brûler la chandelle par les deux bouts. On ne voit plus trop ce que la série a à apporter, et il y a de quoi craindre la fin tant les possibilités semblent réduite à deux choix figés : la mort ou le désespoir.
Saison 6 : 

Quid opus est ea repetere : ce qui s’est passé est amené à se répéter. Cet abruti de Hank a laissé passé sa chance de refaire sa vie avec une sublime jeune fille, et a choisit de replonger une fois de plus vers Karen, en espérant que cette fois sera la bonne. Mais non, cette dernière veut tourner définitivement cette page et repoussera notre pauvre héros tragique. Pourtant, il est prêt à changer, à avoir une vie seine et respectueuse, allant même jusqu’à accepter de bosser sur la version télévisuelle du Flic de Santa Barbara, le projet avorté de Samourai Apocalypse (avec Brandon T. Jackson a sa place pour jouer le rôle). Ça aurait pu convaincre Karen, si seulement une nouvelle merde du passé ne s’était pas manifestée, chamboulant une fois de plus sa vie : un fils. Peu avant d’avoir rencontré Karen, Hank sortait avec la belle Julia (Heather Graham), et elle lui avait caché l’existence de son fils, Levon (Oliver Cooper), qui a fini par se dévoiler plus de deux décennies plus tard. Un peu spécial, limite psychopathe, il va compliquer davantage encore sa relation avec la mère de sa fille, qui n’est désormais plus la seule mère de son unique enfant, mais qui doit partager cet honneur avec une autre, qui en plus a été la première. Quasi impossible de recoller les morceaux après ça, Hank va néanmoins entrevoir une possible fin heureuse avec Julia pour qui l’alchimie est restée intacte. Mais monsieur n’apprend jamais de ses erreurs, et il lui refera le même coup qu’à Faith. Pour les autres personnages, excepté donc sa seconde famille, leurs histoires n’évoluent que peu : Marcy et Charlie continuent à essayer de se retrouver malgré les emmerdes et Stu qui ne lâche rien, tendis que Becca est en vadrouille jusqu’à l’avant-dernier épisode, mais de toute façon son personnage n’a jamais été très intéressant et elle ne nous manque pas une seule seconde. On se concentre donc sur Hank, qui réapprend à être un père, un amant dévoué, pour au final faire volte-face, car c’est et ça a toujours été Karen. Un choix régressif, du bonheur dans la douleur, mais il a toujours été un éternel romantique et cette fin lui correspond bien, et même si on aurait préféré qu’il tourne la page et tente autre chose, ça reste un beau passage plein de tendresse. Une fin pas totalement finie, comme pour dire que de toute façon la vie continue, laissant quelques histoires en plan, mais ça fait l’affaire, et globalement cette dernière saison, sans faire preuve de véritable génie, boucle la boucle en tenant ses promesses. Pas d’apothéose mais un contrat rempli.
Saison 7 : 

Après sept saisons de beuverie, de roulage de joins et de chattes léchées, l’écrivain le plus dépressif de l’histoire nous quitte paisible, le sourire aux lèvres, sa Karen chérie aux bras. Nom de Dieu, tout ça pour en finir au même point qu’à la fin de la saison 1, même si il semblerait que les choses soient actées et définitives cette fois-ci. Sept saisons à courir après la même femme, à baiser des centaines d’autres, à subir une malchance colossale et leurs merdiques retombées. Heureusement, chaque saison a apporté son lot de surprises, de personnages attachants, et chacune avait une intrigue bien spécifique, mais tout de même, tout ça pour finir à accepter le monde et les gens tels qu’ils sont, c’est un peu long. Voilà pourquoi dès la cinquième saison une certaine forme de lassitude s’est installée, particulièrement persistante en sixième saison avec l’erreur « Faith », qui aurait très bien pu marquer la fin d’une histoire et le début d’une nouvelle : savoir lâcher prise et vivre la vie comme elle vient. Mais non, il est vrai que la vie peut avoir plus à offrir, et la dernière saison l’a bien prouvé en offrant à Hank la chance de retrouver une vie de famille magnifique avec un fils et une femme qui l’aiment. C’était beau, c’était simple, mais toujours le même problème : c’était une possibilité agréable, mais Karen hantait inlassablement ses pensées, et il fallait tenter le tout pour le tout, encore, en laissant à nouveau tout derrière lui. À croire que sa vie ne vaut la peine d’être vécue que pour les instants passés avec elle. On a du mal à le comprendre, c’est douloureux et incertain, mais c’est elle qui l’anime, et on ne peut que s’incliner face à une romance aussi idéalisée et poétique, car s’il a décidé de trouver son bonheur de cette façon, alors rien d’autre ne saurait le combler. Car après tout c’est ça Californication : une quête de vérité mélancolique et tragique sur nos rêves et nos désirs. Et s’il y a bien une chose à retenir de tout ça, c’est que l’important est de trouver la chose qui nous tient le plus à cœur, et de tout faire pour y arriver. L’amour est le meilleur moteur de vie, et la série aura su le montrer avec une authenticité crue, et un grand merci à David Duchovny pour avoir su représenter et véhiculer ces valeurs avec tant de justesse.