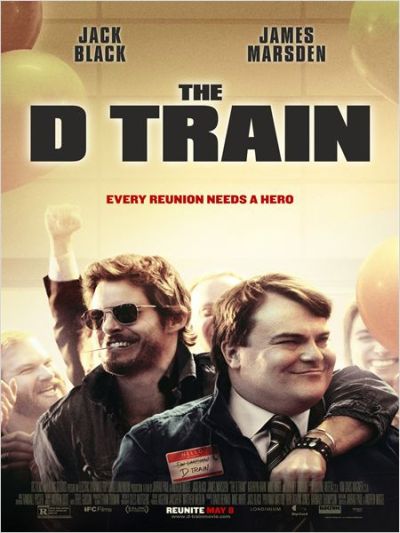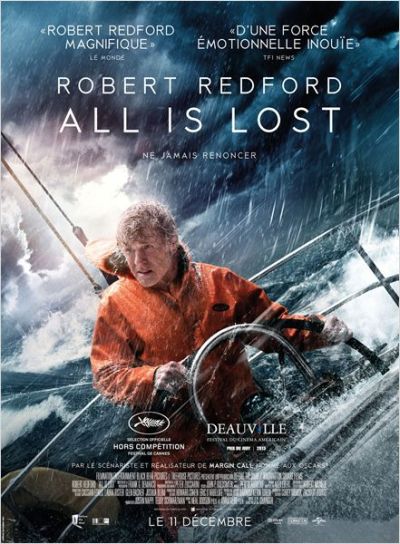Le Mouton enragé
1974
Michel Deville
Vous vous demandez si vous avez un quelconque pouvoir de séduction ? Vous qui reculez à l’idée qu’une femme puisse être éprise d’un autre, vous doutez de la possibilité de pouvoir charmer toutes les femmes qui soient ? Vous ne savez pas comment évoluer professionnellement, et vous vous dites que de toutes façons vous n’avez peut-être pas ce qu’il faut pour prétendre à plus ? Bref, votre amour propre n’est pas au beau fixe, mais au fond vous n’êtes pas sûr que cela chance quelque chose. Eh bien détrompez vous : celui qui sait où il va, et fait ce qu’il faut pour, y ira sans peine.
Petit employé de banque médiocre, Nicolas Maillet (Jean-Louis Trintignant) ne se posait jusque là pas beaucoup de questions, se disant que le peu qu’il avait lui allait à peu près bien, surtout depuis sa rencontre avec la jeune et belle Marie-Paul (Jane Birkin), égayant son quotidien. Mais un jour, son ami Claude (Jean-Pierre Cassel), souhaitant le tester pour les besoins d’un roman qu’il écrit, lui demandera de séduire la femme d’un ami (Romy Schneider) au cour d’un dîné. Un petit jeu malsain va alors débuter, Claude tenant les rennes du destin de son ami, mais les résultats vont s’avérer stupéfiants. En suivant ses conseilles, Nicolas va devenir un grand séducteur, riche et puissant.
C’est bien beau de se moquer, mais encore faut-il être capable de prendre ça sérieusement. On se dit que foncer c’est le meilleur moyen pour se manger un mur, que de l’ouvrir y’a pas mieux pour se manger une mandale, mais au fond personne ne le fait jamais, ou que très rarement grâce à un remède miracle appelé « alcool ». Une méthode qui mériterait une expérimentation, car la mise en pratique laisse rêveur. Au début on se dit que ça n’est que folie, que l’ami se joue de lui, mais c’est bien là la plus bluffante des expertises. Voir cet homme pas très grand, pas spécialement beau ni musclé, chiant comme la pluie et à la culture d’une huître devenir le plus grand Don Juan de l’histoire, c’est cocasse, et donc extrêmement jouissif tant c’est une ode à l’espoir. Même si le dernier virage est bizarrement négocié, on tient là une œuvre très drôle et bigrement originale. Ça a parfois du bon d’être un mouton quand on a un tel berger.