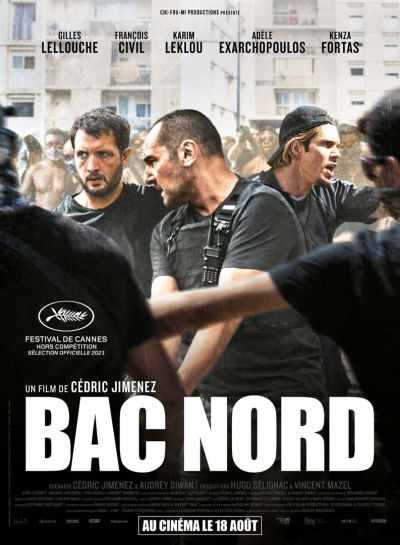Free Guy
2021
Shawn Levy
Passé assez largement inaperçu en France avec moins de 600 000 entrées, malgré une sortie simultanée Disney+ et donc un piratage massif il fut pourtant l’un des premiers vrais succès en salles, car malgré l’avalanche de stars et des effets spéciaux en pagailles, certains savent mieux gérer leur budgets que d’autres, affichant seulement 115 M$ de budget, rendant la somme amassée en salles de 331 M$ plus que correcte, au point d’avoir voulu lancer directement une suite. Un parcours quasi inespéré pour ce film mainte fois reporté et dernier gros blockbuster de la Fox produit avant le rachat par Disney, mais qui a visiblement eu droit à quelques reshoots pour pousser un peu plus loin le délire en profitant des droits de la firme aux grandes oreilles.
Croisement improbable entre la série Westworld et les jeux-vidéo GTA, le film raconte l’histoire de Guy (Ryan Reynolds), un simple PNJ (Personnage Non Jouable) du jeu online Free City, sorte de réplique de New-York où les gens font absolument n’importe quoi, vol, destruction, braquage et autre rodéo urbain, bref tout ce qui serait illicite et violent pour se libérer de la frustration du quotidien et expulser leurs haine. Un univers vidéoludique somme tout classique, et jusqu’alors les PNJ étaient programmés pour obéir aux joueurs et les laisser faire ce qu’ils veulent (mais sans sexe bien sûr, on reste sur du jeu vidéo grand public). Mais un beau jour, en croisant la route d’une joueuse, Guy va sortir de sa boucle et se mettre à exprimer un libre arbitre inédit.
Que ce soit à l’annonce du projet ou en voyant la bande-annonce, je n’aurais pas parié un centime sur le film, qui sentait à des kilomètres le gros foutraque, blockbuster lambda au scénario inexistant. Il faut dire que le film était vendu comme Deadpool se rendant compte que l’univers qui l’entoure est un jeu et qui décide de faire n’importe quoi avec des pouvoirs archi cheatés. La vérité est bien loin et autrement plus réjouissante : ne sachant ce qu’est un jeu-vidéo, le personnage ne va tout simplement pas remettre en cause sa réalité (au début) mais va voir en son éveil la possibilité d’exprimer ses choix et vivre réellement sa vie. Car derrière ses explosions et son environnement violent à la GTA, le film est une introduction à l’intelligence robotique avec une première forme de vie logicielle mais sans corps physique, et le film arrive même à être pertinent et parfois touchant dans ses propos. Derrière, l’histoire principale du vilain patron (Taika Waititi) qui a volé le projet de deux jeunes (Joe Keery et Jodie Comer) semble un peu banale avec la course à la vérité détenue par le joueur (Channing Tatum), mais les personnages sont touchants, et après l’avoir vu galérer sentimentalement pendant trois saisons de Stranger Things, voir un Steve toujours aussi adorable littéralement créer de la vie par amour pour montrer cet amour avec un jeu d’acteur si beau, on se dit que le blockbuster décérébré qu’on pensait nous a bien eu. Les enjeux sont là, l’action est efficace, la mise en scène spectaculaire, la déferlante d’effets spéciaux est pleinement justifiée et de fait réussie (à part peut-être l’incrustation du visage de Dude, mais vu l’état du projet ça pourrait être voulu), et outre l’humour qui marche à blinde, surtout dans la séquence fan-service avec Chris Evans, le film fait souvent preuve d’une finesse surprenante, comme la pique sur les armes à feu. On est loin du niveau intellectuel d’un Westworld et notre cerveau ne sera pas retourné, mais le film est étonnamment profond et bien écrit, drôle, dynamique, touchant, et efficace dans tous les genres qu’il aborde, que ce soit la SF, l’action ou la romance. Un concept qui ne payait pas de mine, mais assurément l’une des meilleures surprises de l’année.