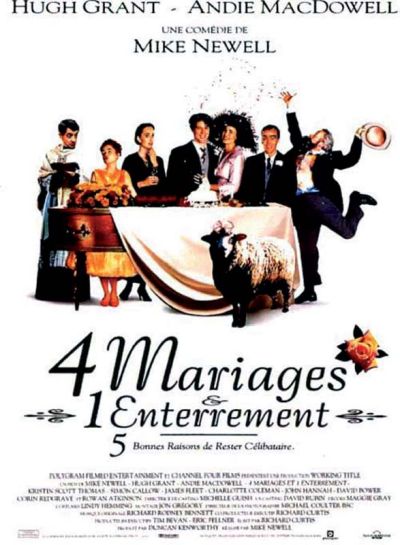Rebel Moon : Partie 2 – La malédiction du pardon
2024
Zack Snyder
Si déjà la première partie fut assez cryptique, la seconde fit plus consensus en étant pour tous un rejet massif. Comme quoi, il faut toujours attendre les versions director’s cut quand il s’agit de Zack Snyder, même si cette fois il est vrai, les critiques ont plutôt raison. Passé l’effervescence créative du premier film, cette suite sera bien plus prévisible et assez largement moins ambitieuse, pour ne pas dire carrément décevante.
Comme menacé dès les prémices, et après avoir cru y avoir échappé en croyant avoir tué le général Atticus Noble (Ed Skrein), le Monde Mère va finalement bien débarquer sur Veldt pour réquisitionner toutes les récoltes, et surtout s’attaquer aux rebelles (Sofia Boutella, Michiel Huisman, Doona Bae et Djimon Hounsou). Ils auront donc cinq jours pour se préparer à l’attaque.
Revenons tout d’abord sur cette connerie monumentale qui semble être bien plus un argument ici, alors que simple prétexte pour traquer les rebelles dans la première partie : la récolte. Vu la taille du vaisseau, même s’il semble – point ô combien frustrant car à l’aura mystique aussi incroyable que le design vertigineux et qui ne sera absolument pas abordé – que la « hatefull bitch » de race biotique / synthétique qui sert de moteur puisse potentiellement réduire drastiquement les coûts énergétiques des déplacements dans l’espace, il n’en reste pas moins que le coût d’un tel transport doit assurément être des millions de fois supérieur à quelques tonnes de blés. Un point de départ absolument ridicule donc. Et pire encore, hormis quelques flashbacks des personnages dont il faudra parler, dont le seul intéressant sera celui sur le roi (Cary Elwes) à la naïveté désarmante, l’intégralité des trois heures de film ne tourneront qu’autour de cette querelle de nourriture entre le Monde Mère et les petites paysans. Des bases bien faibles, et il faudra même attendre plus d’une heure entière pour qu’enfin le film démarre. Pour comparer, j’ai d’ailleurs zappé un peu dans la première version de cette seconde partie, sous-titré L’Entailleuse, eh bien plus de la moitié des scènes rajoutées le sont au début, passant donc de 35 à 70 minutes pour simplement voir ce village exister et moissonner les premiers jours, dont une scène de sexe de près de dix minutes qui n’apporte vraiment rien. Or non seulement leurs flashbacks n’apporte rien qu’on ne savait déjà, mais c’est vraiment laborieux et maladroit. Les deux scènes de malaise dans la salle commune sont au delà du ridicule, notamment la petite paysanne qui les côtoie depuis deux jours et qui se met à leur faire de grandes déclarations de remerciement. Totalement inapproprié et puéril. On dirait la petite cousine qui vient faire un poème à un repas de famille où on se mord les joues pour ne pas rire du ridicule.
Un plantage ahurissant donc ? Sur le premier tiers, sans l’ombre d’un doute, mais heureusement, malgré le côté Rambo V de l’affrontement qui a de quoi faire frissonner, cet aveu d’échec d’avoir fait revenir le même antagoniste, le forçage autour du robot (Anthony Hopkins) qui finalement ne sert quasiment à rien dans aucune des deux parties, et que le lore ne sera plus du tout développé, le spectacle est assuré. Une fois passé la phase d’entraînement, on aura droit à plus d’une heure intense de guerre débordant de générosité. Et heureusement, car sinon on aurait eu l’impression que 90% du budget était passé dans la première partie, même si au final on sent que ça a dû être 70-30. Mais là encore, ça reste assez frustrant : les rebelles arrivent quand tout est déjà fini, et l’entité suprême demandant à Kora de libérer ses sœurs pourrait être un coup dans le vent si la saga ne se prolonge pas. Or il s’agit du point névralgique de la technologie permettant le voyage à travers les galaxies, donc le laisser en suspend est criminel. On garde certes le côté prometteur de l’univers, quelques personnages sympathiques, mais cette suite, après une introduction interminable, se limite donc à du spectacle un peu balourd. Bien maigre consolation pour une saga qui même en director’s cut reste assez poussive…