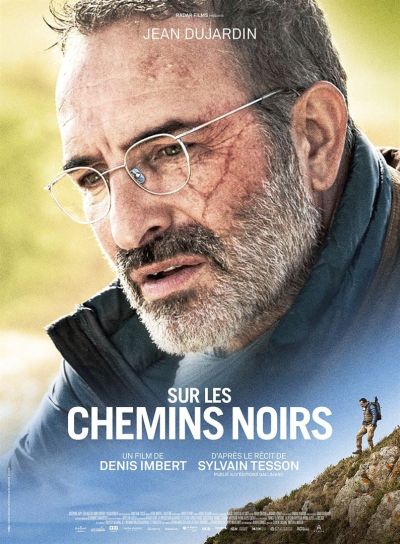Oppenheimer
2023
Christopher Nolan
Nous y voilà : l’un des plus gros événement cinématographique de l’année, le biopic de trois heures sur l’inventeur de l’arme nucléaire qui a frôlé le milliard au box-office. Un prodige dû principalement à son réalisateur, Christopher Nolan, qui a assurément su se forger la réputation d’être le plus grand cinéaste actuel, voir le plus grand de tous les temps. L’homme qui a sauvé le cinéma du Covid avec Tenet, son film qui m’a pourtant le moins convaincu personnellement, car derrière son imagerie exceptionnelle, un casting incroyable et un concept fort censé retourner le cerveau se cachait une histoire banale à souhait, voir un peu bancale. Mais le revoilà en bien belle forme, à défaut de spécialement marquer l’histoire.
Le film retrace le parcours de Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), le scientifique qui se sera vu confier le projet Manhattan, cette course contre les allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale pour être les premiers à concevoir une bombe nucléaire. Outre le projet et comment il est devenu un scientifique de renom à qui l’on confie le sort de l’humanité, l’histoire se focalisera aussi sur le tribunal militaire visant à le destituer de ses privilèges administratifs et salir sa réputation.
Passons rapidement sur les évidences propres au cinéma de Nolan : oui, le film est époustouflant, très bien rythmé malgré les trois heures au compteur, la gestion du suspense est maîtrisée et joue avec le fait que l’histoire est connue de tous, s’attardant donc plus sur les à côtés, le comment du pourquoi. Tâchons aussi de citer les noms les plus illustres figurant à ce casting débilement légendaire : Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Harnett, Casey Affleck, Rami Malek, Jason Clarke, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Gustaf Skarsgard, Dane DeHaan, Gary Oldman, Devon Bostick, Olivia Thirlby ou encore Alex Wolff. Tout le monde n’arrivera pas à vivre avec tant de personnages et d’illustres acteurs, mais la plupart auront leur moment d’importance, et dans l’ensemble les performances sont excellentes, notamment Robert Downey Jr. dont le rôle est le second plus important du film et qui prouve que son jeu ne se limite pas à jouer les playboys comiques. Le scénario est bien ficelé, prenant, permettant de raconter l’envers du décor de la grande histoire.
Passons maintenant aux quelques réticences qui en font un excellent film, mais pas un chef d’œuvre absolu. Si la musique est impressionnante, elle fera parti des moins marquantes de Ludwig Göransson, et son utilisation, de même que le son en général, est assez balourd, voulant trop rythmer le film de manière épique sans que cela ne soit forcément justifié. Le scénario, bien que très bon, souffre de cette même maladresse, cherchant à ériger un mythe ayant le poids du monde sur ses épaules, et non à raconter l’histoire d’un homme. A l’image de la toute dernière scène : c’est classe, mais un peu grandiloquant. On pourrait faire la même réflexion sur la réalisation avec le choix des passages en noir et blanc pour les scènes dans l’époque la plus proche de nous. Déjà dans l’imaginaire collectif c’est une connerie, on devrait plutôt avoir du noir et blanc pour les passages les plus anciens, pas les plus récents. Mais en réalité c’est pour déjà limiter le plus possible l’usage du noir et blanc, car plus on se rapproche du croisement des timeline plus le présent rattrape la couleur, et c’est surtout prendre le spectateur pour un con, incapable de comprendre autrement que l’action se déroule sur plusieurs époques. De plus, l’aspect politique est un peu moins intéressant malgré quelques twists bien sentis, et clairement le film aurait été encore meilleur sans avec une durée plus proche voir en dessous des deux heures. Un immense film très réussi, mais qui aurait gagné à plus de sobriété en fin de compte.