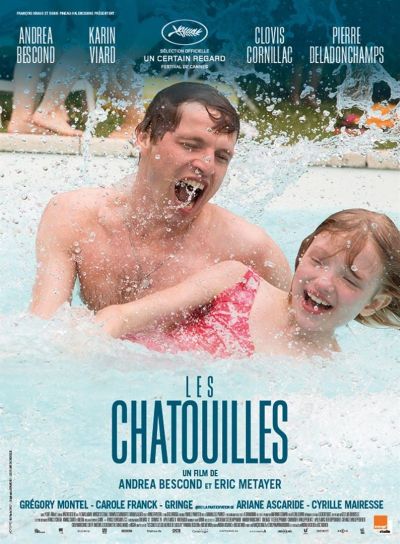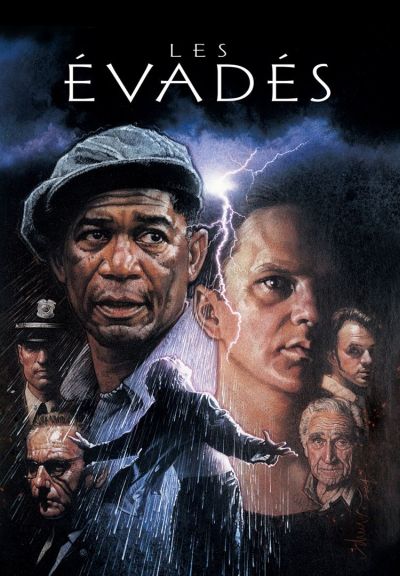Fast & Furious X
2023
Louis Leterrier
Et de onze… Dix films principaux, et un spin-off. Alors que tout le monde est à peu près d’accord pour dire que la saga aurait s’arrêter avec le septième, dont la formule commençait déjà à s’essouffler à force de pallier infranchissable dans la surenchère, la saga a voulu tirer sur la corde tant la machine à cash tournait à plein régime. Il faut dire que la franchise a tellement évoluée qu’elle ne se ressemble même plus, passant de film de malfrat / courses de rue, à du grand cinéma d’espionnage aux ambitions démesurées pour la bêtise et légèreté des débuts. Pour ma part, si j’ai aimé les huit premiers opus, la saga est devenue trop mainstream dès le quatrième volet, et encore plus à partir du cinq. Nous avons perdu la simplicité, le fun des courses, au profit de sous Mission Impossible lambda, gagnant en cascade et épique au sacrifice d’un scénario faiblard. Heureusement, le calvaire touche bientôt à sa fin, la saga devant s’achever par un spin-off en 2024, puis le XI en 2025, sauf décalage par rapport à la grève. Et quand on a déjà vu les neuf premiers et le spin-off, autant aller jusqu’au bout.
Conscient que Fast Five est pour beaucoup considéré comme le meilleur film de la saga (et objectivement, c’est vrai, se battant avec Furious 7 pour le titre, bien qu’au niveau plaisir de revisionnage, les trois premiers sont largement au dessus personnellement), c’est donc en se raccrochant à ce dernier que la saga est censée se terminer. Sorti de nulle part et ayant attendu toutes ces années pour une obscure raison, Dante Reyes (Jason Momoa) a décidé de se venger de la famille (Dominic Toretto (Vin Diesel), Roman (Tyrese Gibson), Letty (Michelle Rodriguez), Ramsey (Nathalie Emmanuel), Han (Sung Kang), Mia (Jordana Brewster) et Jakob (John Cena)) qui a volé et tué son père.
Après la catastrophe du neuvième opus, les dérives ahurissantes sur les salaires gonflant le budget à 340 M$ (Brie Larson aurait apparemment touché 10 M$ pour deux jours de tournage), le réalisateur et scénariste claquant la porte en plein tournage, un yes man appelé en renfort alors que l’acteur principal s’improvisait réalisateur, sur le papier le naufrage était annoncé. Et encore une fois, on nous sort d’un chapeau magique un antagoniste « là depuis longtemps alors qu’on ne le savait pas ». Une écriture incroyablement mauvaise, annonçant déjà la couleur. Partant de là, il n’y avait pas une marge terrible pour faire encore pire, et on remonte presque un peu la pente. Oui, l’histoire est encore complètement à chier, mais elle ne sera pas polluée par des flashbacks toutes les trois secondes comme le précédent, donc c’est déjà ça de gagné sur le rythme. On aura pas mal de scènes d’action sympa, notamment celle à Rome. On est content de revoir furtivement Deckard (Jason Statham), on s’en fout de sa mère (Helen Mirren), Cipher (Charlize Theron) pas mieux, et comme d’habitude on nous ressuscite du cul un personnage qu’on croyait mort, Gal Gadot. Comment croire à la mort de qui que ce soit dans des conditions pareilles ? Le niveau d’écriture est d’ailleurs constamment gênant entre les gens qui n’étaient pas là mais qui savent quand même une information qu’ils ne devraient pas savoir, ou encore le traitement de Brian, héros des premiers volets et mort tragiquement en 2013, mais qui est censé être encore en vie dans les films. Or non seulement son absence est injustifiable, mais depuis sa mort les films font régulièrement des passages touchants clin d’œil, qui dans le cadre du film n’ont aucun sens. Si la question morale de réutiliser son image comme pour finir Furious 7 se pose, il a plusieurs fois était question de le faire revenir de la sorte depuis, et il faudrait réellement le faire pour le tout dernier volet, la saga le lui doit. Reste à savoir ce que proposera le spin-off avec le retour de Hobbs (Dwayne Johnson) teasé en fin de film ici, mais il est peu probable que la saga n’arrive à proposer une fin plus satisfaisante que ce qu’aurait été la fin si tout s’était arrêté avec Furious 7.
Une suite très mal écrite encore une fois, un méchant qui en fait des caisses, un raccrochage nostalgique arriviste, mais un bien meilleur rythme, des cascades plus « réalistes » malgré des incohérences de taille. On s’ennui donc, et les heures de gloires semblent bien loin, mais on limite les dommages pour un spectacle presque correct. La suite ne laisse que peu d’espoir quant à une fin à la hauteur, et il aurait tellement mieux valut que l’acteur investisse son temps et son argent sur la prochaine aventure de Riddick tant le potentiel est bien plus grand. Un projet constamment confirmé mais en attente depuis dix ans. Avec un score au box-office à peine supérieur à 720 M$ malgré un contexte infiniment meilleur que le Fast & Furious 9 sorti en plein Covid qui fit quelques millions de plus avec un budget tiers de moins, on devrait tout de même voir la fin de tout ça, mais voilà qui calmera les ardeurs du studio quant à un trop plein de spin-off ou suites. Il faut vraiment que tout ça s’arrête à force.