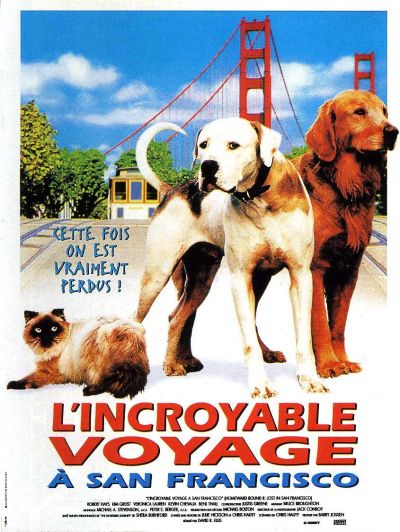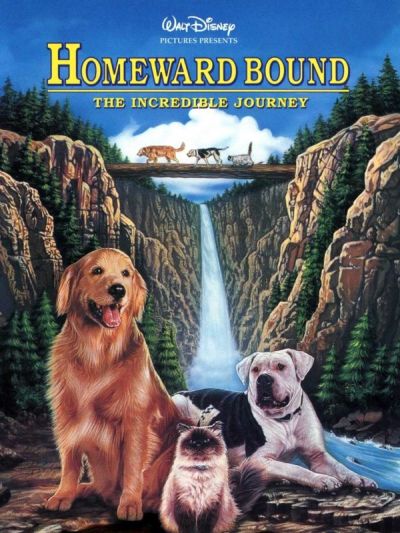La Belle époque
2019
Nicolas Bedos
Partant avec un mauvais à priori sur l’homme entre son père qui m’a toujours insupporté, et lui dont les interventions télévisuelles laissaient paraître un homme froid et atrocement hautain, le film ne partait pas gagnant. Alors certes, le long-métrage avait fait pas mal parler, jouissant d’excellentes critiques aboutissant à un joli succès (près de 1,3 millions d’entrées), mais pas assez pour réellement faire passer le cap du visionnage. Mais voilà, ce faisait parti des films notés « pour plus tard », et que j’avais pratiquement fini par en oublier l’existence. Puis vint un soir à la télévision.
Semblant presque être un préquel à la toute meilleure série de l’histoire, Westworld, le film part d’un principe similaire, mais transposé avec les moyens d’aujourd’hui. Antoine (Guillaume Canet) est ce qu’on appelle un vendeur de nostalgie, de rêves, mais réels. Disposant de locaux aménageables à l’image de studios de cinéma de grande ampleur, il possède tout, peut tout créer et mettre en scène selon les envies, grâce à des costumiers, décorateurs et acteurs. Vous voulez vivre une soirée à la Downton Abbey ? C’est possible. Revivre la fougue des années 60 ? Tout est faisable, il suffit d’y mettre le prix. Une passion pour redonner vie au passé qui va trouver un écho formidable en son mentor, l’homme qui a fait de lui celui qu’il est devenu : Victor (Daniel Auteuil). Père d’un de ses amis d’enfance qu’il a toujours admiré, de le voir en pleine dépression face à un monde moderne de plus en plus triste, à une femme l’ayant quitté, il va décider de lui redonner goût à la vie en le plongeant dans la période la plus heureuse qu’il n’ait jamais connu : les années 70, où il était jeune, heureux, et rencontrant tout juste l’amour de sa vie.
Le principe est juste génial. Certes, pouvoir faire tout ce que l’on veut, y compris tuer ou violer des gens comme dans Westworld serait l’étape ultime, mais nécessitant de fait de faux humains synthétiques, donc voir comment on pourrait déjà dans la pratique à l’heure actuelle proposer ce genre de plongée, c’est juste incroyable. Eh puis cessons la mauvaise fois deux minutes. Oui, on a aujourd’hui tous les progrès technologiques et médicaux, mais ça n’est que poudre aux yeux face au plaisir de vivre, qui paraissait si simple et naturel il n’y a encore pas si longtemps. Donc oui, qui ne rêverait pas de pouvoir s’y replonger ? Le film le fait avec tellement de justesse, de noblesse, de poésie, et le casting est incroyable, chaque acteur jouant à la perfection. Un fait évident pour des vétérans comme Fanny Ardant, Pierre Arditi ou Denis Podalydès, mais Doria Tillier est une fabuleuse révélation, participant d’autant plus à cette fascination nostalgique. La mise en scène est réussie, le scénario est bien pensé, nous surprenant toujours sur le niveau de perfectionnisme. Alors oui, l’histoire reste assez simple, mais son charme nous emporte totalement et il faut saluer une telle originalité si qualitative dans le paysage cinématographique français.